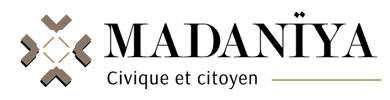Dernière mise à jour le 21 novembre 2014
par Aziz Krichen, ancien conseiller du président Mouncef Marzouki
« J’espère simplement pour lui, comme jugement final, quand les générations suivantes feront le bilan de notre époque troublée, qu’elles ne se souviendront que du courage dont il fit preuve lorsqu’il s’opposait à la dictature de Ben Ali, et qu’elles auront la charité, ou l’élégance, d’oublier tout le reste ». Aziz Krichen à propos de Mouncef Marzouki.
Tunis, 21.11.04 – Selon le point de vue où l’on se place, le résultat des dernières élections législatives peut être interprété de façon très différente. On peut, si l’on s’en tient à une lecture partisane, soit être ravi par la victoire de Nidaa Tounes et le reflux des islamistes, soit ressentir une vive amertume en se disant que, quatre ans après le soulèvement populaire qui chassa Ben Ali de Carthage, c’est le RCD qui revient au pouvoir sous un autre accoutrement.
En revanche, lorsque l’on fait l’effort de se dégager de ses propres préventions idéologiques, lorsque l’on examine les choses en profondeur, qu’on les analyse sous l’angle de l’intérêt national et de la consolidation de notre démocratie naissante, on est légitimement en droit d’éprouver un véritable sentiment de soulagement et de foi en l’avenir – un sentiment fondé, basé sur des faits qui englobent et dépassent tout le monde, aussi bien les gagnants que les perdants de ces élections.
Pourquoi un tel optimisme de ma part? Pour une raison très simple, qui relève d’une notion fondamentale en politique: la question du rapport de force.
Au sortir d’une longue période de dictature – et la Tunisie a vécu un demi-siècle sous pareil régime – il est pratiquement exclu de trouver des partis pleinement constitués, entièrement acquis aux valeurs de la démocratie, et aptes à diriger le pays sans dommages pour l’Etat ni pour les libertés des citoyens. Ces partis ne peuvent pas exister, précisément parce que c’est le rôle de la dictature que de les empêcher d’exister.
Dès lors que semblables partis politiques n’existent pas au départ, ce qui permet de dire si un processus de transition a ou non des chances de réussir, c’est la présence ou l’absence, dans le champ partisan, de solides mouvements concurrents. Des mouvements d’importance à peu près équivalente, capables de se limiter mutuellement, et dont la compétition se développe inévitablement à l’intérieur de contraintes multiples: poids et contrepoids, poussée et contre-poussée, mobilisation et contre-mobilisation.
A l’usage, cet ensemble de relations contraignantes finit par imposer les règles de la négociation, du compromis, de la recherche de solutions consensuelles aux situations de conflit, toutes pratiques qui constituent autant de pré-conditions objectives à la formation progressive d’un système politique authentiquement démocratique.
Le passage à la démocratie n’est jamais, en effet, une affaire de bons sentiments. Il ne se décide pas entre des acteurs désintéressés, uniquement préoccupés par leur attachement à l’universalité des droits de l’homme. Il ne devient possible que par l’établissement préalable d’un vrai pluralisme partisan, qui interdit de facto la monopolisation du pouvoir par une seule composante.
Il ne devient une réalité que lorsque la différentiation effective de l’espace politique oblige les divers protagonistes à rechercher les moyens de garantir leur coexistence réciproque.
Dans une telle optique, nous avons connu en Tunisie trois moments-clés depuis l’indépendance. Il y a d’abord eu les élections de la première Constituante en 1956. En raflant la totalité de la centaine de sièges à pourvoir, les listes néo-destouriennes avaient remporté une victoire écrasante.
Le déséquilibre absolu des forces entre le parti de Bourguiba et ses rivaux communistes, vieux-destouriens et indépendants, allait automatiquement engendrer, peu de temps après et pour cinquante-cinq ans, la tyrannie du parti unique et le fléau du pouvoir personnel.
La deuxième date charnière, c’est octobre 2011 et la désignation de l’ANC. Les élections ayant été plus disputées et incomparablement plus libres, le tableau issu du scrutin ne pouvait pas être aussi grossièrement monolithique. Il restait cependant gravement déséquilibré, marqué par un écart trop élevé entre le score réalisé par le mouvement Ennahdha (42% des sièges) et celui obtenu par ses poursuivants immédiats (autour de 10% des suffrages pour le CPR et Ettakattol). C’est la répartition encore très inégale des forces qui explique, pour l’essentiel, la dérive hégémonique des islamistes sous les gouvernements Jébali et Larayedh, ainsi que la succession de crises qui faillirent mettre plusieurs fois en péril la poursuite pacifique de la transition.
Troisième moment marquant et troisième tournant, les récentes élections législatives. Rappelons les principaux résultats: pour Nidaa Tounes, 37% des suffrages et 86 sièges; pour Ennahdha, 28% des suffrages et 69 sièges. En termes de structuration du système politique, cela signifie que le pays dispose à présent de deux grandes formations partisanes, dotées d’une influence et de ressources globalement comparables, mais dont aucune n’est en mesure d’accaparer seule le pouvoir, d’en exclure l’autre, et encore moins de l’éliminer.
Ces données empiriques sont d’une importance capitale pour la défense et la préservation de nos libertés. En quatre ans, nous sommes passés d’une forme de pluralisme relatif (octobre 2011) à une situation de pluralisme équilibré et mature (octobre 2014). La progression n’est pas seulement quantitative, elle est qualitative; ce n’est pas un changement de degré, c’est un changement de nature.
Indépendamment de ce que les uns et les autres nous pouvons penser de l’orientation d’Ennahdha ou de Nidaa Tounes, il s’agit là d’un accomplissement politique d’une portée historique majeure, en ce sens où les pré-conditions objectives de la démocratie – l’existence d’un rapport de force équilibré entre formations partisanes concurrentes – sont maintenant pleinement établies et réunies.
Le pluralisme est désormais une réalité définitivement ancrée dans les faits et dans les consciences. A partir de là, on peut affirmer qu’il n’y aura plus de retour en arrière possible. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que nous ne rencontrerons plus d’obstacles sur notre chemin, qu’il n’y aura pas d’incidents de parcours et que nous ne connaîtrons pas de nouvelles turbulences. Les difficultés sont inévitables, inséparables de la vie telle qu’elle est. Mais le destin de la Tunisie est dans la démocratie, il n’est plus dans le despotisme.
Le tournant pris est irréversible. C’est la première grande bonne nouvelle apportée par les élections législatives. Il y en a une seconde, encore virtuelle, mais dont je ne doute pas qu’elle se vérifiera dans les prochaines semaines: l’apaisement des tensions idéologiques entre islamistes et séculiers.
Etant donné la gravité des défis économiques, sociaux et sécuritaires qu’il faut relever, étant donné également la composition du nouveau Parlement – à coté des blocs compacts formés par Nidaa Tounes et Ennahdha, le reste de la représentation nationale est éclaté entre une dizaine de groupes différents – il paraît plausible, en effet, pour assurer l’autorité et la stabilité du prochain gouvernement, que l’on soit amené à opter pour une formule de large rassemblement qui inclurait, par conséquent, une participation du parti de Rached Ghannouchi. Si cette hypothèse se confirme, et tout indique qu’elle doive l’être, le climat politique du pays en serait radicalement transformé.
Contraints de travailler ensemble, les deux principaux partis seraient obligés de mettre une sourdine à la rhétorique identitaire qui leur a permis jusqu’ici de se démarquer l’un de l’autre. Il deviendrait alors possible de commencer à traiter les problèmes de fond qui entravent depuis des décennies le développement du pays – et qui sont à l’origine du soulèvement populaire de décembre 2010, janvier 2011 –, problèmes de fond jusqu’ici occultés en raison précisément de la focalisation du débat national sur les questions d’identité.
S’il se produit, pareil apaisement créerait aussi un environnement favorable pour la poursuite de la maturation de notre système politique. Celui-ci est aujourd’hui organisé autour de deux partis centraux, lesquels ensemble ne sont finalement représentatifs que d’environ 30% du corps électoral effectif (2,5 millions d’électeurs, sur près de 8 millions de Tunisiens en âge de voter). C’est dire si le fossé qui sépare l’élite politique actuelle de la grande masse de la population demeure béant.
Depuis 30 à 40 ans, la bipolarisation a pratiquement interdit l’émergence de mouvements politiques suffisamment consistants pour pouvoir proposer une alternative crédible, affranchie de la tutelle des deux pôles de l’échiquier. Les résultats des partis se réclamant de la mouvance démocratique et progressiste aux élections de 2011 et 2014 en sont la preuve tangible.
Si la bipolarisation devait s’estomper – et il est de l’intérêt du pays qu’elle s’estompe –, la construction d’une nouvelle offre politique pourrait devenir un projet réalisable. Et l’espace serait enfin libéré pour la constitution d’une troisième grande force politique, à la fois moderne et populaire, patriote et démocrate…
Quelques mots pour conclure sur l’élection présidentielle en cours. Au vu de la perspective d’ensemble qui vient d’être tracée, cette élection apparaît décalée, anachronique, sans enjeux réels, un peu comme si des joueurs continuaient à se mesurer sur le terrain après que l’arbitre eut sifflé la fin de la partie. La modestie des prérogatives accordées au chef de l’Etat par la nouvelle loi fondamentale et le fait que la présidentielle se tienne après les législatives, prive en effet l’événement de tout intérêt véritable.
Cette espèce d’imposture constitutionnelle n’a cependant pas dissuadé des dizaines de candidats à se lancer dans l’aventure. Dans le tas, on peut relever la présence de quelques personnalités respectables. Cependant, en dehors de BCE, on voit mal comment tous les autres concurrents peuvent justifier – non pas légalement, mais politiquement et moralement – leur démarche: à supposer qu’ils soient élus, ce qui est hautement improbable, sur quelle majorité parlementaire qu’ils n’ont pas vont-ils s’appuyer?
C’est cette contradiction de base qui explique sans doute le retrait de plusieurs postulants ces derniers jours. Quoi qu’il en soit, les dés ont été jetés et la campagne a bel et bien démarré. Dans la mêlée confuse qui a suivi, un homme s’est rapidement détaché et semble parti pour se qualifier pour le second tour.
Il s’agit de Moncef Marzouki, dont j’ai été le conseiller durant deux ans à Carthage, avant de démissionner en désespoir de cause. Quel procédé a-t-il utilisé pour parvenir à se hisser au rang de principal challenger?
Je ne veux pas accabler le personnage. Force est néanmoins d’admettre que sa stratégie de campagne n’a été guidée que par un seul objectif: réactiver, à son bénéfice, les clivages idéologiques qui divisent les Tunisiens contre eux-mêmes. C’est-à-dire qu’il s’est inscrit d’emblée dans une pente qui va à contre-courant de l’évolution du pays et de la sauvegarde de sa jeune démocratie.
Cette posture irresponsable est la sienne depuis les tristement fameuses déclarations faites au Qatar en mars 2013. Depuis, la dérive n’a fait qu’empirer, pour devenir proprement scandaleuse aujourd’hui. Peu lui importe qu’une telle politique ravive les tensions parmi la population, ni qu’elle fasse le lit de l’extrémisme et incite à la violence. Lui en attend des retombées électorales et rien ne compte davantage à ses yeux.
Moyennant quoi, profitant du nombre élevé de candidats et de la dispersion des votes, Moncef Marzouki sera vraisemblablement présent au second tour. Encore plus vraisemblablement, il sera alors battu. Et quittera la scène par la petite porte. J’espère simplement pour lui, comme jugement final, quand les générations suivantes feront le bilan de notre époque troublée, qu’elles ne se souviendront que du courage dont il fit preuve lorsqu’il s’opposait à la dictature de Ben Ali, et qu’elles auront la charité, ou l’élégance, d’oublier tout le reste.
Aziz Krichen.