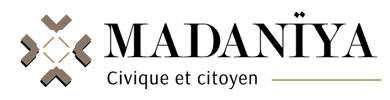Dernière mise à jour le 16 mars 2017
Note de la rédaction : Les jongleries financières de la France à propos de la construction de la Mosquée de Paris.
Quand le projet de Mosquée à Paris a été relancé en 1895, le sultan Abdelhamid approuva et envoya un chèque de 500.000 F. Mais les promoteurs du projet butèrent sur une hostilité quasi-générale. Seuls les Comtistes islamophiles (NDLR : Les positivistes musulmans disciples d’Auguste Comte) firent preuve de persévérance et défendirent le projet d' »Institut d’Etudes Supérieures Franco-Arabes ».
À la faveur de la fraternité d’armes de la Grande Guerre, ils réussirent à convaincre de l’utilité du projet Hubert Lyautey, ministre de la Guerre, puis premier Résident général de France au Maroc, en 1912.
Le futur « Maréchal de l’islam » confia à la Société des Habous des Lieux Saints créée en 1917, la construction de la mosquée mais sans l’Institut. L’Etat avança la somme de… 500.000 F, qui avait été envoyée par Abdelhamid un quart de siècle plus tôt.
Et le jeune pouvoir saoudien réclamait la restitution des biens des « Habous de la Mecque et Médine » qui avaient affectés à la construction de la Mosquée, indûment aux yeux du cheikh Rachid Réda, qui conseillait le gouvernement d’Ibn Séoud. Mais la valeur symbolique l’emporta sur ces ambiguïtés et contentieux. la France a fait un geste de nature à satisfaire les musulmans francophiles qui continuaient à l’appeler « Dawla Al Habiba », malgré tout.
Le « Maréchal de l’Islam avait même jusqu’à préconisé un « Califat Occidental ». La mal nommée « Ad Dawla Al Habiba », (l’État bien aimé) se vivait comme la « premier puissance de l’Islam arabe », face à la Grande Bretagne, « première puissance musulmane au Monde » avec l’Union Indienne englobant davantage de musulmans que la totalité des pays musulmans réunis.
La France se vivait en ces temps-là vizir à la place du vizir, calife à la place du calife, survivance d’une islamologie coloniale.
Ce texte est extrait de l’ouvrage de l’auteur « La France et ses Musulmans » (Fayard-2006) de Sadek Sellam, écrivain et historien franco-algérien, grand connaisseur de l’Islam français, que www.madaniya.info propose à ses lecteurs en guise de contribution à une meilleure connaissance de la problématique de l’Islam en France. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
I – LE PROJET DE CALIFAT OCCIDENTAL DE LYAUTEY
Les déclarations de loyalisme auprès des chefs maraboutiques.
La Première Guerre mondiale renforça l’alliance avec les confréries nouée par l’Administration au début du siècle. La surveillance de ces ordres, qui avaient été hostiles durant trois quarts de siècle, était au cœur de la politique musulmane.
Leur transformation par l’État laïque en instrument politique en fit le premier « islam politique » du XXe siècle. L’entrée en guerre de l’Empire ottoman aux côtés de l’Allemagne amena l’Administration française à exiger des déclarations de loyalisme de tous les chefs maraboutiques (1).
Le ministre de la Guerre demanda au général Lyautey, « Commissaire résident général de la République au Maroc », d’obtenir des chefs de la Taïbya de Ouazzan une déclaration de nature à mettre en garde ses nombreux affiliés de l’Ouest algérien contre le calife ottoman.
Lyautey dépêcha à Ouazzan un de ses agents qui obtint en un temps record le texte recherché, la « spontanéité » de ses signatures étant aussi assurée que celle de Youssef, comme ironisait le général dans sa correspondance avec Paris.
Il s’empressa de présenter un projet plus ambitieux par lequel il pensait pouvoir saper le prestige du calife auprès des sujets et protégés musulmans de la France dans tout le Maghreb, voire au-delà : il voulait créer un califat occidental avec le sultan du Maroc, Moulay Youssef, à sa tête.
LE CALIFAT OCCIDENTAL: une veille idée de l’islamologie coloniale
Lyautey tenait beaucoup à ce projet. Il avait commandé une étude à ce sujet au secrétaire général du gouvernement chérifien, Gaillard (2), et avait appuyé l’argumentaire de celui-ci en envoyant au ministre des Affaires étrangères un plaidoyer plus long que l’étude elle-même.
Le général vivait encore dans la vieille idée de l’islamologie coloniale selon laquelle « le musulman de Tunisie et d’Algérie n’existe que par La Mecque et Constantinople », mais croyait beaucoup à une exception marocaine.
À l’en croire, ses protégés étaient imperméables aux idées « panislamistes » venues de la capitale ottomane, et « l’impuissance » de cette idéologie au Maroc résultait du recrutement de « ses zélateurs (lorsque ce n’étaient pas simplement des Juifs) parmi les Jeunes-Turcs détachés de l’orthodoxie musulmane et faisant appel au fanatisme religieux pour servir des fins politiques (3).
Il se félicitait du repli du Maroc sur lui-même, ce qui l’avait « immunisé contre le virus du progrès ».
Pour ce qui est de La Mecque, il estimait que « notre objectif doit être d’affaiblir progressivement et discrètement le lien du pèlerinage, et non de le perpétuer en le doublant par le lien du khalifat (4)». Il mettait en garde contre le chérif de La Mecque qui s’était proclamé anticalife. Le soutien à ce candidat serait « la pire des solutions ». Il n’ignore pas que cette candidature avait été préparée par le Foreign Office, et il voulait que la France ait sa propre politique.
La proclamation du califat occidental devrait être le fondement de cette attitude hostile à la fois au calife ottoman et à son rival l’anticalife de La Mecque. Il estimait même possible la reconstitution de l’empire des Almohades (al Mouwahidoun, les unificateurs) sous l’égide de son homme lige, le bon, accommodant et « modéré » Moulay Youssef.
Cette référence aux « unificateurs » du Maghreb, du Sahara et de l’Andalousie aux XIIe et XIIIe siècles servait à mieux « fractionner le khalifat » sunnite, ce qui était plus facile qu’avec un « simple caïdat », un jeu d’enfant à la résidence de Rabat.
« Dans le domaine religieux, comme dans le domaine politique, nous avons plus intérêt à diviser qu’à unifier… Il ne s’agit pas de savoir si l’unité religieuse de l’islam français est un bien ou un mal, mais si cette unité n’est pas la seule garantie contre un mal bien pire : l’unité de tout l’islam, y compris le nôtre, sous la primauté d’un chef étranger ou hostile (5). »
Lyautey vante les mérites de l’unité des possessions africaines de la France « dans l’obédience d’un khalifat docile à nos inspirations, parce que profondément solidarisé avec nos intérêts ». Il y voit « la meilleure garantie contre des excitations dangereuses, notamment contre l’action des confréries qui se retrouve dans toutes les insurrections. […]
Cette action, si facile à exercer là où l’absence d’une autorité religieuse lui laisse le champ libre et, par contre, si difficile à contrôler parce qu’elle est à la fois secrète et disséminée, serait plus efficacement combattue par un khalifat occidental que par le clergé officiel de l’Algérie (6).»
Un sultan proclamé calife par la France ferait ainsi pièce aux menées britanniques, préviendrait les insurrections et donnerait à réfléchir aux Espagnols qui manquaient de révérence pour le souverain alaouite : « Enfin, pour ne parler que du Maroc, le prestige restauré de ce khalifat serait pour nous un précieux moyen de peser discrètement et indirectement sur la zone espagnole, d’y déjouer les intrigues qui continueront toujours à s’y nouer contre nous et de forcer les autorités espagnoles qui affectent d’ignorer le sultan de compter avec lui, c’est-à-dire avec nous (7).»
Il souligne la facilité avec laquelle son protégé pourrait être reconnu calife par les musulmans des régions sahariennes et africaines.
En Algérie, « la situation est beaucoup plus simple, puisqu’il n’y a plus de khalifat et qu’une simple décision des autorités françaises suffirait pour imposer celui du sultan du Maroc (8).» En Tunisie, où les « protégés français » sont soupçonnés de « turcophilie » (9), Lyautey propose une préparation des esprits « sous le couvert de personnages religieux, marocains et tunisiens, qu’il faudrait d’abord rapprocher les uns des autres, afin de créer entre eux une atmosphère propice (10)».
Dans son étude sur le califat, Gaillard se montre plus précis : il propose une véritable manipulation des théologiens de la Zitouna de Tunis par ceux de la Qaraouine de Fès, eux-mêmes dûment conditionnés par les islamologues de la résidence (11).
Après avoir exposé ses arguments de politique musulmane régionale et de géopolitique mondiale, Lyautey fait état de sa « marocophilie » inconditionnelle et n’hésite pas à recourir au concept de « race ». Il impute le calme des trois quarts des territoires marocains pacifiés, malgré le voisinage des zones belliqueuses de la Siba, au fait « que cette race marocaine, si bien douée au point de vue commerce et affaires, ressent davantage les bienfaits de son association avec nous que l’Algérien amorphe et paresseux (12)».
Ses réelles sympathies pour le traditionalisme de Fès, considéré comme le meilleur allié de l’ordre établi, ont inspiré ces formules moins heureuses à Lyautey, que l’émir Chékib Arslane appelait « le plus intelligent des colonialistes français (13)».
Dans ses échanges avec Paris, et pour mieux démontrer la supériorité de son grand dessein sur toutes les autres propositions, il qualifie de « calembredaines » les solutions proposées pour combattre l’action de l’Allemagne sur les musulmans : création d’un sous-secrétariat d’État de l’Afrique du Nord, nomination de conseillers musulmans, construction d’une mosquée à Paris et « autres panacées (14)».
Le ministère de la Guerre reconnaît qu’il propose une « solution beaucoup plus séduisante », mais objecte que le succès de Moulay Youssef « ne sera définitif que lorsque les Algériens auront abjuré le sultan de Constantinople au nom duquel ils font encore la prière, même en Oranie (15)».
II – LA MISSION POLITIQUE ET MILITAIRE AU HEDJAZ ET LA SOCIÉTÉ DES HABOUS
Les objections sont également de caractère historique : « en dehors du Maroc et du royaume de Tlemcen, les sultans maghrébins» n’ont « jamais été reconnus comme chefs de l’islam».
Le ministère de la Guerre admet la pertinence du projet qui ne s’appliquerait « qu’à la concentration de nos musulmans de l’Algérie occidentale sous la suprématie religieuse du sultan du Maroc dont vous tirez les ficelles».
Mais « le sultan du Maroc, ne peut-il pas être tenté, un jour ou l’autre, d’employer contre la France le pouvoir spirituel étendu que nous l’aurions aidé à conquérir ? Ce danger ne serait-il pas à envisager le jour où vous seriez conduit à passer à des mains inhabiles la résidence générale (16)?»
Les placides spécialistes de la « question d’Orient » du Quai d’Orsay ne retinrent pas le projet de califat occidental, jugé sans doute trop fantasque. Mais surtout ils étaient convenus avec les Britanniques d’apporter un soutien au chérif Hussein de La Mecque, sur lequel Lyautey reportait sa méfiance envers le Foreign Office. Ainsi fut décidé l’envoi de la « mission d’Égypte (17)».
À la demande du Quai d’Orsay, Lyautey choisit quatre Marocains pour la « mission politique », le cinquième étant Si Kaddour Benghabrit. Né en 1873 à Sidi Bel Abbès dans une famille originaire de Tlemcen établie au Maroc pour fuir l’occupation, celui-ci avait été élève de la medersa d’État d’Alger.
En 1902, son nom apparut dans la Revue de l’islam qui annonçait la création, sous son égide, d’une « école arabe-française » à Tanger sur le modèle des établissements ouverts en Algérie par le Second Empire et fermés par la IIIe République au nom d’un laïcisme assimilationniste hostile à la langue arabe.
Cet établissement entendait répondre aux besoins des familles marocaines « protégées » par le consulat de France qui appréciaient le bilinguisme des médersiens algériens recrutés par le Makhzen, lequel en était tellement satisfait qu’un dahir signé par Moulay Abd al-Aziz en 1894 accorda la nationalité marocaine à tous les Algériens du royaume, y compris les Juifs partis avant le décret Crémieux (18).
La légation française de Tanger était à l’origine de cette initiative parce qu’elle préparait l’extension du protectorat à tout le royaume chérifien. Benghabrit était employé comme drogman à la légation, mais son rôle réel était beaucoup plus important. Revoil disait de lui qu’il « était la moitié de la question marocaine ». Le comte de Saint Aulaire, qui alors dirigeait cette légation avant de finir ambassadeur de France, a retracé les services rendus par cet interprète apparemment modeste. Il le décrit comme « la maîtresse carte, l’atout qui sauvera la mise de la France malgré l’inexpérience du joueur (19)». Voilà pourquoi le Quai d’Orsay tenait à l’imposer à Lyautey qui n’appréciait pas particulièrement un personnage aussi bien introduit à Paris et ailleurs.
Lyautey tint à inclure dans la délégation politique Si Ahmed Skiredj el-Fassi qui avait demandé à son frère, chef de la confrérie Tidjanyia à Tanger, de produire une fatwa sur le califat.
Cet avis juridico-religieux contestait durement la légitimité des Ottomans et approuvait formellement le chérif Hussein dans la mesure où il s’opposait aux Turcs. Il énumérait les droits et les mérites de la « dynastie chérifienne, alaouite et hachémite, qui, dans la splendeur de sa gloire, avait toutes les qualités requises pour exercer l’imamat au Maghreb, ainsi que pour le protéger et le conserver.
C’était le projet de Lyautey lesté par des rappels historiques et des citations extraites des textes canoniques (Coran, Hadith, droit malékite) (20).
La mission politique et les musulmans de la mission militaire se rendirent à La Mecque. Non autorisés à traverser le périmètre sacré de La Mecque, le lieutenant-colonel Brémond et son état major restèrent à Djedda où il n’y avait pas (encore) de combats (21).
La question du pèlerinage était au centre des préoccupations de cette mission. Il s’agissait de prouver à l’opinion musulmane que les pays de la Triple Entente étaient militairement en mesure d’assurer la navigation jusqu’aux lieux saints et de montrer leur respect pour la religion musulmane. En second lieu, le fait d’encourager le pèlerinage et d’accroître le nombre des pèlerins devait renflouer les caisses du chérif Hussein qui en avait bien besoin. L’« aide » britannique était surtout d’ordre politique et diplomatique (22).
Cette mission fit l’objet de commentaires enthousiastes dans la presse, célébrant l’alliance « de Verdun à La Mecque (23)». En janvier 1917, l’académicien Louis Bertrand publia une série d’articles sous le titre « La France et l’islam », dans L’Écho de Paris ; ils furent traduits en arabe et publiés intégralement dans le journal Al Qibla de La Mecque (24).
Cet intérêt soudain pour le pèlerinage étonna les partisans du califat. En Algérie, où l’opinion musulmane considérait le calife d’Istanbul comme le symbole de l’unité de l’islam – même si des poèmes lui reprochaient de n’avoir pas sauvé Alger en 1830 –, Hussein était très mal vu, comme le montrent les qualificatifs peu flatteurs utilisés aussi bien en arabe dialectal qu’en kabyle (25).
L’intellectuel égyptien Mohamed Farid prit la défense du califat et ironisa sur l’usage du pèlerinage à des fins politiques. Dès 1912, cet observateur avisé avait attiré l’attention dans Le Siècle sur les desseins britanniques en Orient : « Mettre la main sur le califat et proclamer calife un de ces princes musulmans qui convoitaient cette haute fonction religieuse, pour étendre leur éphémère pouvoir sur d’autres régions encore et pour s’enrichir davantage (26).»
L’Angleterre fut la première à reconnaître l’indépendance du chérif Hussein et autorisa les fidèles d’Égypte et des Indes à aller faire leurs dévotions à La Mecque. Elle fit supprimer par le gouvernement égyptien les conditions vexatoires imposées à ses ressortissants pour diminuer le nombre des pèlerins sinon pour empêcher complètement le pèlerinage.
La France suivit sa rivale dans cette voie : le président Poincaré envoya au Hedjaz une mission civile et militaire française musulmane pour féliciter le chérif, et le gouvernement mit des bateaux à la disposition des pèlerins du nord de l’Afrique pour les amener jusqu’à Djedda et les ramener dans leur pays gratuitement (27)…
Farid dénonçait au passage le journal Al Mostaqbal publié en arabe à Paris par Choukri Ghanem, G. Samné et C. Kheirellah, qui croyaient pouvoir éviter l’accusation de « panislamisme » en adhérant au nationalisme arabe, comme le recommandait l’orientaliste Carra de Vaux.
Ses campagnes contre le califat ottoman et pour le chérif Hussein lui valurent d’être interdit en Afrique du Nord à cause de ses attaques contre le calife qui indisposèrent les musulmans.
Au retour de la mission fut créée une association de droit musulman, la Société des habous des lieux saints de l’islam (28), dont les statuts furent déposés à la mahkama hanéfite d’Alger le 16 février 1917, pour faciliter le séjour des pèlerins maghrébins et africains à La Mecque et à Médine – où furent construits deux immeubles destinés à leur hébergement.
III – PRISONNIERS DE GUERRE ET « RESPECT » DE L’ISLAM
Les soldats musulmans [des armées alliées] capturés par les Allemands furent regroupés au camp de Zossen notamment. On accusa l’émir Saïd al-Jazaïri, fils de l’émir Ali, de s’être rendu en Allemagne en 1916 « pour débaucher les soldats prisonniers maghrébins et les persuader de combattre pour la Turquie et de tourner leurs armes contre la France (29) ».
De son côté, le Comité musulman pour l’indépendance de l’Afrique du Nord, qui avait été créé à Berlin en 1915, organisait des réunions rehaussées par la présence des émirs Abd el-Malek et Ali (30), à l’intention des détenus musulmans.
Ali s’occupait particulièrement des prisonniers algériens dont certains étaient libérés et vantaient le « respect de l’Allemagne pour l’islam ». Pour les convaincre de ce « respect », le CMIAFN leur faisait visiter des mosquées ouvertes en Allemagne au XIXe siècle (31). L’une d’elles datait du début du XIXe siècle (32).
La pratique religieuse des prisonniers était fortement encouragée, et une nouvelle mosquée fut inaugurée en grande pompe. Les interdits alimentaires étaient rigoureusement respectés et les fêtes religieuses ostensiblement célébrées.
Des échos de ce « respect de l’islam par l’Allemagne » parvinrent dans les douars par voie de courrier rédigé dans un style ésotérique, que même le service de contrôle n’arrivait pas toujours à déchiffrer (33).
La France, « plus grande puissance musulmane arabe » versus la Grande-Bretagne, « première puissance musulmane »ait rester indifférent
La France, « plus grande puissance musulmane arabe (34)», ne pouvait rester indifférente à ces commentaires qui soulignaient une réelle inégalité. D’autant moins que la Grande-Bretagne, « première puissance musulmane » avait des mosquées depuis 1895, comme celle de Woking, dont l’ouverture par les Ahmadyia avait été soutenue par le Foreign Office qui, bien avant Lyautey, s’était employé au « fractionnement ».
C’est dans ce contexte que le vieux projet d’érection d’une mosquée à Paris parut intéressant à des hommes politiques qui étaient restés indifférents aux arguments moraux, historiques et politiques exposés par les tenaces et fervents défenseurs d’une politique musulmane cohérente. Ce que le raisonnement ne réussissait pas à faire admettre, la guerre le rendit acceptable. La comparaison du « respect » de l’islam par la France avec les « égards » manifestés pour cette religion par son ennemi héréditaire et son allié et rival en Orient permit de vaincre les dernières réticences.
Pour aller plus loin
- https://www.madaniya.info/2016/10/24/la-nouvelle-fondation-de-l-islam-ou-les-nouvelles-formes-de-dirigisme-religieux/
- https://www.madaniya.info/2016/02/12/des-rapports-entre-les-socialistes-francais-et-l-islam/