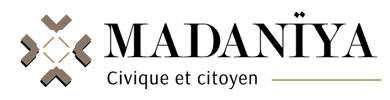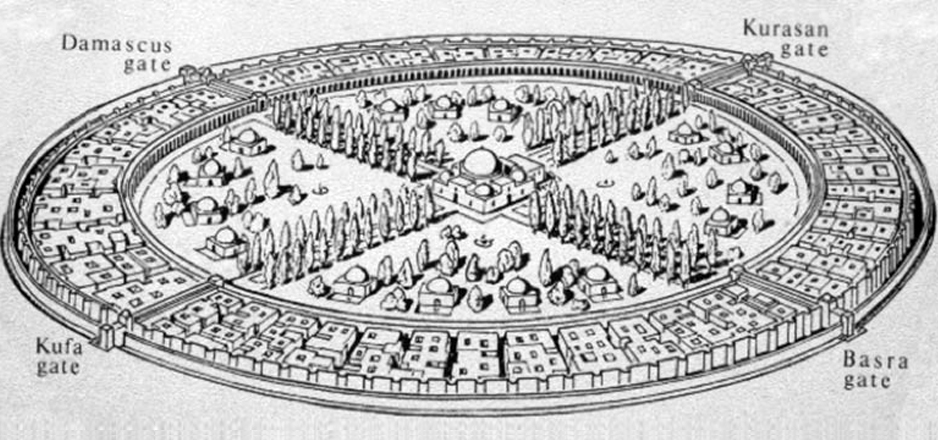Dernière mise à jour le 6 décembre 2017
8- La fiction des Khulafa’ Rashidun
C’est du fond de cet horizon d’attente que la fiction des Khulafā’ Rashidūn serait venue aux musulmans. Ils l’ont naturellement acceptée, allant de soi comme une «vérité» qui ne venant de nulle part passait pour avoir été toujours-déjà-là. C’est à mettre en scène la représentation de la croyance en cette «vérité» du Califat Heureux que la fiction des Califes Bien Guidés fut vouée ; une représentation qui soit telle que celui qui y croit et lui est assujetti ne puisse que croire en elle dès lors que dans cette représentation l’acteur, la scène et le destinataire sont sur le même plan : les musulmans sont tout à la fois, les destinataires de la fiction, ses auteurs («inconscients» devrait-on ajouter) et les acteurs de la scène du spectacle, comme acteurs de la crise fitnique : c’est par et avec eux que s’est construit cette fiction comme mise en scène de la sortie de la fitna !
C’est bien pour cela qu’à la lecture «réaliste» de ceux qui opposent «réalité/imaginaire», on préfèrera d’autres qui s’expliqueraient, chacune, par sa raison d’être, le tout s’originant dans la fitna.
Trois raisons d’inégale importance me semblent devoir être retenues pour appréhender l’institutionnalisation, en milieu sunnite, de cette fiction.
- La première proprement politique est liée à la da‘wa(1) des Abbassides.
- La seconde, s’inscrivant dans la temporalité conflictuelle du califat fitnique – que j’appellerai «récit/fiction de démarcation et de partage» – serait, elle, liée au conflit qui opposa ceux qui se dénommeront «sunnites» contre tous les «sortants» des rangs du «consensus de la umma».
- La Troisième et dernière enfin, la symbolique, qui s’inscrit, elle, dans la temporalité de l’islam prophétique.
Conçue comme stratégie de prise du pouvoir, la da‘wa abbasside, quand elle fut lancée, consista à dénigrer les Omeyyades leurs ennemis, certes sur tous les plans mais plus spécifiquement au plan de leur «conformité à la Tradition islamique» établie. Leur mise à plat emprunta deux axes d’attaque : au niveau des faits et de l’histoire ; au niveau de l’imaginaire sunnite. Au niveau des faits, ils leur reprochèrent d’avoir rompu le «‘urf» établi par les premiers califes, les Bien Guidés, d’une élection à la transmission par consultation des (proches) Compagnons et non par hérédité.
Avec les Omeyyades, dès Mu’āwiya, le premier d’entre eux, on passa brusquement d’un principe de succession «consensuel» au principe dynastique, présenté par la propagande abbaside comme un reniement.
Reniement souligné en abîme par la bid‘a de l’Imam (2) et de l’Imamat : une hérésie qui, se confondant avec rawāfid, sert aux sunnites à dénommer les chiites.
La dissemblance religieuse vint s’adjoindre au conflit politique autour de la succession. Si pour les sunnites en effet, le Prophète était à la fois un guide spirituel et un chef temporel, sa succession, elle, ne pouvait être que temporelle – et pas du tout «spirituelle» le temps de la révélation s’étant clos avec la mort du Prophète.
Pour les chiites par contre, la prophétie est doublée par l’Imamat. S’appuyant sur le Coran3 et des hadīth4, ils affirment que le Coran a une surface un sens exotérique ou visible (zāhir) et un sens ésotérique ou caché (bātin). Et pendant que le Prophète n’en a révélé que le sens exotérique, il revient à l’Imam d’en relever le sens ésotérique. C’est en ce sens que les chiites ont compris le dit attribué à ‘Ali : «le Coran ne parle pas» (Al-Qur’ān lā yantuq), il lui faut donc un interprète qui ne peut être que l’Imam. Comble de bid‘a, pour l’orthodoxie sunnite, et donc source de fitna.
9 – La fiction du Califat Bien Guide, une ligne de démarcation entre les Sunnites et les «sortants»
Au plan du «Grand partage», liée au conflit qui opposa ceux qui se dénommeront « sunnites »(5), aux « sortants » des rangs de la umma – ces dissidents ces déviants – la fiction du Califat Bien Guidé servira à tracer une ligne de démarcation – et comme tel un «signe de reconnaissance» – entre ceux qui suivent la «voie droite», les sunnites, contre tous les autres ; cette ligne de partage passera bien évidemment par la reconnaissance – ou pas – de la légitimité des trois califes élus avant ‘Ali, mais délégitimés comme usurpateurs par les «sortants» (chiites et kharijites confondus) parce qu’élus à la place de ‘Ali, seul successeur légitime – aux yeux des seuls chiites, d’où leur (sur)nom de rawāfid(6).
Or pour en arriver là, et changer la perception des évènements et celle de de l’autre-en-islam, fut institué, à l’époque abbasside, le récit de la fiction du Califat Bien Guidé pour battre le pavillon de la da‘wa abbasside, car une da‘wa, pour se lancer et mobiliser, se doit de se battre au nom du «vrai islam» (en l’occurrence, celui des Abbassides) contre un islam fāsiq, pervers et dévoyé (celui des Omeyyades). Par comparaison avec le règne des Omeyyades, le Califat Bien Guidé, régime «heureux» s’il en fut, servira ainsi de repoussoir et permettra que l’on précipitât les Omeyyades. Ce n’est peut-être pas encore une diabolisation mais c’est sûrement une stigmatisation doublée d’une exclusion.
Le symbolique, s’il reprend à son compte l’opposition de «ce qui est» à «ce qui n’est pas», en change néanmoins la perspective ajoutant un «encore» à «ce qui n’est pas» : ce qui n’est pas encore.
Du coup, elle ne se lit plus en termes d’exclusivité, «réel» vs «non-réel/irréel ou imaginaire», mais dans les termes d’une opposition entre deux ordres aux échéances incommensurables, contraires mais non contradictoires : l’ordre du «réel» et de la «vérité de fait», la vérité de «ce qui est» ou «a été» : un califat fitnique ; vs l’ordre de la «vérité de droit» de ce qui doit être dans la mesure où cette vérité – le Califat Heureux, ici symbolisé par le Califat Bien Guidé – quand bien même il n’aurait pas été, «sera parce qu’il doit être», et il ne peut qu’être puisque portée par l’eschatologie de la parole prophétique.
C’est bien cet ordre «du droit» qui met en récit la «vérité» du Califat Heureux en Califat Bien Guidé, et comme telle, d’une vérité qui ne serait ni opposée à la réalité ni non plus indexée sur le réel. Elle se présente comme nécessaire mais dans le temps indéterminé, nécessaire mais conditionnée, son accomplissement étant suspendu à la volonté divine.
Dès lors, on n’opposerait plus, comme dans la lecture «réaliste», le fait au non-fait, mais le fait à la vérité comprise comme signe, ouvrant par là le champ de l’avenir humain (à tout le moins musulman sunnite) au possible divin. Aussi le récit du Califat Bien Guidé s’est-il constitué en une scène de fiction où se déploie une histoire idéale qui réconcilie les sunnites avec l’Histoire, et dans laquelle ils se déploient comme sujet de cette fiction.
C’est par recours au contrepoint que la tradition sunnite a pu légitimer la fiction des Khulafā’ Rashidūn en lui assignant un «lieu» de vérité : la parole même qui en parle, et parole à travers laquelle se dit le monde qui fait le monde des musulmans, celui au sein duquel ils aspiraient à vivre.
Et c’est effectivement par l’intermédiaire du récit du Califat Bien Guidé que fut soulagé l’antinomie du savoir et du croire, de l’histoire et de la fiction, de la réalité et de l’imaginaire, puisqu’il fallait tout à la fois, et contradictoirement, savoir la «réalité malheureuse» du califat des Premiers temps (objet de la narration historique et populaire) et croire à la «vérité» heureuse du Califat, objet de l’imaginaire et de la fiction, et du discours savant sur le Califat, sa nature, sa fonction, soin statut, bref ce qui doit en être pour se légitimer. Parallélisme que l’on peut suivre tout au long de l’histoire de l’islam où narration et fiction ont coexisté, chacune d’entre elles allant son chemin, juxtaposées sans s’influencer.
Paradoxe d’une telle coexistence que j’expliquerai pour ma part par le fait que leur finalité et les enjeux qui s’y rattachaient, étaient (et le sont toujours) différents.
Si ceux de la narration sont de relater les faits en les authentifiant, pour la fiction, plutôt que d’accréditer contre les faits l’inaccréditable, sa finalité aura été, je pense, de tracer une frontière entre l’acceptable et l’inacceptable : la réalité fitnique du califat qui est un savoir, acceptée et reconnue comme tel ; et ce qui ne peut ni ne doit être accepté ou reconnu : l’impossibilité d’un Califat Heureux qui relève du croire ; car pour ce faire et que s’établît cette frontière, la logique de production de cette fiction a pénétré les logiques et les modalités – non pas de la fixation des événements, œuvre des chroniqueurs – mais du sens à leur donner.
Si les musulmans sunnites se sont donc accommodés de la réalité fitnique du califat, ils s’en accommodèrent selon le double moulinet du contrepoint : pendant qu’ils acceptaient la réalité «malheureuse» et s’y résignaient, ils n’acceptaient pas qu’elle s’imposât comme seule et unique «vérité».
C’est bien cette impossibilité d’un Califat Heureux que nie l’imaginaire de la fiction des Khulafā’ Rashidūn. Certes, ce qui est nié, c’est toujours une réalité, mais il s’agit cette fois de la réalité d’une expérience collective et historique, sans cesse renouvelée et renouvelée en premier sous la guidance de l’excellence des Compagnons du Prophète (Abu Bakr, ‘Umar. ‘Uthman, ‘Ali) ; et au creux de cette négation liminaire, se dissimule une autre, celle de l’impossibilité d’une umma Une et réconciliée avec elle-même selon l’injonction du Prophète.
10- À Chaque imaginaire, sa réalité
Comme l’on voit, à chaque imaginaire sa réalité. L’imaginaire où s’inscrit la fiction des Rashidūn, laisse entendre que la réalité fitnique du califat des Premiers temps (le savoir et les faits) n’a pas entraîné et (n’entraine toujours pas), ipso facto, l’abandon en la croyance de la «vérité» d’un Califat Rāshid et Heureux.
En dépit des faits, contre eux, par-delà et au-delà d’eux, a pu être sauvegardée du naufrage où elle sombrait l’unité de la umma, peut-être pas comme réalité effectuée dans le «passé/présent» ; mais certainement comme «Vérité» dans le «présent/avenir» (ou le futur comme il convient de dire aujourd’hui) dès lors que la fiction «à travers ce qui est dit… – ce qu’elle raconte quant à l’histoire des Khulafā’ Rāshidūn – … il y a ce qui se dit» :
Que la umma pourra échapper à son destin, à l’éclatement où l’a vouée le califat fitnique des Premiers temps, et donc que l’expérience décevante du passé ne saurait récuser la croyance certaine en sa nécessite à venir et l’espérance qu’elle induit.
En réduisant, pour réussir à franchir les frontières du réel décevant, la réalité fitnique à l’accidentel, en la soumettant à la seule conjoncture historique, s’affichait dans la fiction que cette vérité décevante ne saurait être la vérité, ou une vérité nécessaire et irréversible : elle aura eu ce mérite immense de sauver ce qui ne pouvait l’être.
11- Donner un sens nouveau à une réalité qu’il fallait maitriser pour être à même de produire un présent
Dans la perspective de ce propos, l’irruption de la fiction des Khulafā’ Rashidūn ne devrait donc pas être interprétée en termes de falsification de la réalité ou de sa méconnaissance…; mais, authentique «acte de création», elle traduirait plutôt l’impérieuse nécessité où se trouvaient les musulmans sunnites à donner un sens nouveau à un passé qu’il fallait maîtriser pour être à même de produire un présent qui pût s’inscrire dans un sens qui allait au-delà de son sens «réaliste», un sens dans la perspective eschatologique d’un avenir porteur du Salut de la umma au sein de son unité retrouvée «comme l’on retrouve un objet perdu», eût pu ajouter Freud. Néanmoins, si la sortie de la fitna représentée par la fiction du Califat Rāshid, se présente comme une nécessité, comme toute chose est selon la volonté d’Allah, c’est une nécessité reçue comme un don plutôt qu’un dû, une promesse de salut et non une dette.
12- La proclamation de l’État islamique du Calife Ibrahim : une déclaration blasphématoire en ce qu’elle établit une comparaison entre des termes -le Prophète/al-Baghdādi- incommensurables
Or donc le 29 juin 2014, en plein mois du ramadan qui coïncide avec le début de la révélation coranique, ash-shaykh, al-Moudjāhid, Abu Muhammad al-‘Adnāni ash-Shāmi7, porte-parole officiel de l’État Islamique, proclame la restauration du califat quelque quatre-vingt-dix ans après son abolition par Atatürk, sur des territoires qui relèvent de deux Etats, l’Irak et la Syrie, de la postérité de l’exécution de l’Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale.
Cette proclamation intempestive a remis en mémoire la question du califat en terre sunnite. Qu’en fut-il exactement de sa réception auprès des milieux concernés ?
Fut-elle perçue comme s’inscrivant dans le sillage du tableau de l’imaginaire ici rapidement esquissé ? ou bien en rupture avec, initiant un nouvel imaginaire ? Fut-elle acceptée ou rejetée ?
En s’arrogeant le droit de déterminer l’indéterminable temps du Califat Heureux, la proclamation califale d’Abu Bakr al-Baghdādi semble s’être inscrite en rupture avec la promesse prophétique (8). Ce n’est pas la restauration du califat comme tel qui a été rejeté par la masse des musulmans sunnites dits «modérés», mais son modus operandi : son mode de proclamation et de naissance. Si son comportement public a dû sûrement contribuer à son rejet, ce rejet en recouvre un autre – tu certes, mais à fleur du dire -, et qui me semble à moi nécessaire quoiqu’il n’ait pas mérité attention.
Car alors l’attention fut prise par quatre des aspect de cette restauration : bien évidemment, par son comportement public «sauvage», qui s’originerait dans un rigorisme qui n’accepte pour islamique que seulement ce qui peut être authentifié par le sceau du moment prophétique ou, à tout le moins, par celui des Premiers Compagnons, lequel s’achèvera avec la fin du Califat Bien Guidé et la mort de ‘Ali ;
- Un second aspect, la dimension géopolitique de l’entreprise néo-califale qui balayait la balkanisation régionale des Provinces arabes de l’Empire ottoman, voulue à l’époque de leur puissance par la Grande-Bretagne et la France, aux lendemains de la Première Guerre mondiale
- Le troisième retenu, la résurgence de l’imaginaire califale, dit abusivement «islamique», qui ne se serait jamais (?) désillusionné et travaillerait toujours, semble-t-il, la psyché musulmane ; le quatrième peut être la soumission de l’Occident non-musulman à la sharī’a et, pour ce faire, «purifier» l’islam de ses éléments «hérétiques», nommément chiites et soufis
- Enfin le dernier retenu, la mise en scène apocalyptique de la «mission» du califat, qui, dramatisant à l’extrême l’affrontement avec l’ennemi, joue pleinement, en pathos, sur le registre de l’urgence
Or il est un autre enjeu, resté dans la pénombre, qui n’a pas mérité attention. Se situant sur un autre plan, on en retrouve les traces, les signes ou les indices, mais nettement et très clairement, dans le discours de Proclamation de la restauration du califat, lu par al-‘Adnā’ni.
Discours plaidoyer qui, afin de plaider sa cause et légitimer le califat (auto)-proclamé, s’essaie à justifier la légitimité de l’entreprise califale.
Cette légitimation se fait, tout au long de la plaidoirie, dans les termes d’un parallèle entre deux périodes de l’histoire islamique -celle prophétique/celle d’aujourd’hui-, qu’elle fait se correspondre homologiquement terme à terme.
Dans les deux cas, les Arabes à l’époque prophétique/les musulmans d’aujourd’hui, étaient/sont dans la Jāhiliyya : ils étaient/sont impuissants et humiliés, pauvres et sans ressources. Or, il a fallu un Prophète pour sauver les Arabes de la Jāhiliyya, il faut donc de nos jours, une sorte de «délégué» du Prophète, pour sauver les musulmans d’aujourd’hui de la nouvelle Jāhiliyya (9).
En s’autoproclamant calife, Baghdādi s’affiche comme l’homme providentiel, choisi par le Prophète et agréé par Dieu, pour conduire à bien cette mission.
Parallèlement aux raisons de son immoralité et de sa «sauvagerie», c’est du fait de cette homologie que l’État Islamique aurait été, me semble-t-il, et le serait toujours, rejeté par la masse des musulmans sunnites dits «modérés» : parce que, dans l’absolu, c’est une proclamation blasphématoire qui établit une comparaison entre des termes -le Prophète/al-Baghdādi- incommensurables ; et que, relativement aux choses de la succession, la restauration telle qu’elle s’est actée l’a été en dehors de tout «‘urf», de tout modus operandi connu dès lors qu’elle s’est faite en battant en brèche la fiction du «ijmā‘» qui, quoique fictif, semble symboliquement nécessaire pour légitimer une entreprise de ce genre qui se doit de sacrifier à la fiction du «consensuel».
Déplacer le centre de gravité du rejet sunnite vers le modus operandi de la proclamation, permet de mettre au jour que ce qui a été rejeté ce n’est pas la croyance toujours recommencée en la promesse d’un Califat Heureux !
Et je pense, que tant que la croyance en cette promesse ne se serait pas d’elle-même désenchantée elle continuera à figurer dans l’horizon d’attente des sunnites en ce que cette promesse Califat incarne le retour de la umma a elle-même, unifiée sous et par la sharī’a.
Pour aller plus loin
https://www.madaniya.info/2016/07/18/liban-symboles-temps-de-detresse/
Notes
1- Dans son sens courant, da‘wa signifie prédication et se traduit comme «appel à l’islam». Comme tel, ce peut être le fait de tout musulman d’appeler de non-musulmans à embrasser l’islam. Au fil des temps, certains d’entre eux, les prédicateurs (dā‘ia/du‘āt) ont consacré leur vie à prêcher la bonne parole islamique.
Mais da‘wa s’entend aussi autrement, comme dans les expressions «la da‘wa prophétique ; la da‘wa ‘abāsiyya ; la da‘wa fātimiyya ; da‘wat al-Husayn, Etc.», que l’on retrouve sous la plume des historiens musulmans, notamment Tabari et Ibn Khaldūn. Certes, c’est toujours un appel à l’islam, mais d’un autre genre puisqu’il ne s’agit plus de conversion, mais de faire triompher une cause (celle de l’islam, évidemment), en brandissant l’étendard de la révolte contre une dynastie parce qu’elle aurait dévié dans un islam fāsiq (perverti et dévoyé).
Dès lors qu’il s’agit de prise du Pouvoir, cette da‘wa-là devait souscrire à certaines conditions :
- quand le califat était encore le fait des Arabes (avant l’irruption des Turcs qui a tout chamboulé) sahib ad-da‘wa (celui qui lance l’appel) devait être un qurayshite, de la « tribu » du Prophète (Abu Bakr al-Baghdādi n’a-t-il pas fait éditer un opuscule prouvant son ascendance quraychite)
C’est un mouvement à base populaire, bien qu’encadré par les partisans et conduite par une direction, qui se mobilise pour faire triompher la cause de sahib ad-da‘wa, qui se confond en l’occurrence, avec la cause de l’islam.
Elle comprend enfin une sorte de non-dit : l’issue doit en être heureuse, sanctionnée par la victoire, c’est-à-dire la conquête du Pouvoir, pour passer l’éponge sur le temps de la fitna/rupture qu’elle a suscité et prouver par-là que l’Unité de la umma est sauve puisque retrouvée ; et si la da‘wa venait à échouer, elle serait vouée aux gémonies de la fitna et condamnée à l’oubli «officiel». La da‘wa, l’abbaside (qu’on a appelé Révolution abbasside, ce qui n’a pas de sens), la fatimide, Etc., souscrivent en gros à ce protocole que l’on peut induire de la Muqaddima d’Ibn Khaldūn.
Comme telle, et bien qu’elle comprenne une appréciable mobilisation populaire, da’wa n’est pas, ne peut et ne doit pas être confondue avec «révolution» au sens que lui a donné la Modernité occidentale ; pour une raison à tout le moins : en dernière analyse, une da’wa ne cherche qu’à corriger ou à rectifier le tir – l’exercice du Pouvoir, la pratique de l’islam – mais elle n’a jamais cherché à «révolutionner» le régime islamique : jamais, dans aucune des da‘wa, il n’a été question d’une sortie de l’islam pour proposer un autre régime de pouvoir, un autre discours, une autre «idéologie». Ainsi la «Révolution islamique» de Khomeyni, si elle peut être perçue comme une révolution parce qu’elle a réussi à changer le régime politique en place, il reste que c’est une da‘wa plutôt qu’une révolution au sens moderne du mot : après tout, elle ne cherchait pas à «inventer» un régime politique nouveau, inédit, mais tout simplement à restaurer le régime islamique vieux de l’époque du Prophète ou de l’Imamat.
2- Ne pas confondre l’ »Imam » (Majuscule) du chiisme et l’«imam» (minuscule) de la prière, celui-ci étant celui qui dirige la prière du vendredi et qui est placé «amam»/devant les fidèles le temps de la prière ; il peut s’agir également d’un réfèrent qui fait autorité en matière religieuse, ainsi les fondateurs des mazāhib (écoles juridiques) sunnites ont le titre d’imam.
3- Coran : 3,7 ; 3,190 ; 29,43 ; 72,26-27
4- qui font dire au Prophète : «Le Coran possède un extérieur (zāhir) et un intérieur (bātin), une limite (hadd) et un lieu vers lequel on s’élève (muttala‘)» ou encore : «Le Coran a été révélé selon sept lectures (ahruf); chaque verset a un extérieur et un intérieur»
5- De l’arabe «سني»/sunnī, signifie la «voie», sous-entendue celle suivie par le Prophète. Le mot sunnite en est un dérivé, la «sunna» représentant la ligne de conduite de Muhammad, attestée par ses dires et ses actes – à valeur de modèle – compilés dans des recueils de logions appelés Hadīth. Partant du principe qu’il existerait effectivement quelque part une orthodoxie musulmane facilement identifiable, à l’aune de laquelle il serait facile de mesurer le degré d’aberrations théologiques des uns ou des autres, ceux qui deviendront les sunnites, se prétendant seuls à suivre cette «Voie», se sont érigés en parangon et taxèrent de déviants tous les autres islams.
6- Précisément, ceux qui refusent de reconnaitre la légitimité des trois premiers califes.
7- dont on trouvera l’intégrale en français, ici : http://w41k.com/89121
8- … quand bien même elle s’intitulerait «Ceci est la promesse d’Allah», se donnant pour promesse accomplie.
9- Lieu commun et thème récurrent de ce genre de discours, que l’on retrouve chez, par exemple, Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad ‘Abdel-Wahhab.