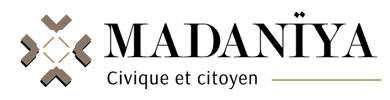Dernière mise à jour le 28 juillet 2018
par Richard Labévière
«Donner raison au reporter reviendrait à s’ingérer dans la politique d’Israël, un état souverain»… La Justice Française.
Enfin une bonne nouvelle, une lueur dans le chaos de l’injustice globalisée : La Cour d’appel de Paris vient, le 21 juin 2018, de condamner le geste fou un sniper israélien qui, il y a dix-huit ans, a visé au cœur le journaliste Jacques-Marie Bourget.
Pas d’excuse juridique possible pour un soldat, un agent, lorsqu’il s’en prend ainsi aux civils, donc aux reporters. Cet arrêt, obtenu par William Bourdon, le défenseur du «correspondant de guerre» blessé, est un monument des droits de l’homme.
Les vrais, pas ceux que Trump et ses amis jettent aux poubelles de l’histoire.
Reste encore à convaincre l’Etat français d’appliquer la décision que vient de rendre le TGI de Paris…
Le 21 octobre 2000 à Ramallah, en Palestine occupée, Jacques-Marie Bourget, alors grand reporter à Paris-Match était très grièvement blessé au poumon gauche.
Transpercé par le tir direct d’un fusil d’assaut américain «M16», arme de dotation d’un soldat israélien. Tir d’un sniper totalement inattendu, sauf à imaginer que le militaire avait pour objectif d’assassiner notre confrère ?
En effet, au moment du drame, la place publique où se tenait Jacques-Marie Bourget était calme et les cafés ouverts à la clientèle, en dépit de l’effervescence du moment, celle de la «Seconde Intifada».
Quelques minutes après le coup de feu les secouristes du Croissant Rouge Palestinien se précipitent pour embarquer le journaliste en état de coma. À l’hôpital de Ramallah les médecins constatent que la situation est très grave.
Qu’étant donné la qualité de journaliste étranger de la victime, il est préférable que l’opération chirurgicale nécessaire se déroule dans un établissement israélien mieux équipé. Questionnés, les responsables politico-militaires hébreux refusent de secourir le reporter qui est donc opéré à Ramallah par des chirurgiens palestiniens qui, hélas, ont une grande habilité en matière de chirurgie de guerre.
Devant l’hôpital des jeunes font la queue pour donner le sang nécessaire aux transfusions du français.
Trente-six heures plus tard, opéré et stabilisé, le journaliste doit être pris en charge par un avion sanitaire et son équipe, expédiés de France, jusqu’à Tel Aviv. Refus des mêmes responsables israéliens de laisser passer l’ambulance palestinienne jusqu’à l’aéroport Ben Gourion. Finalement c’est Jacques Chirac, président de la République, qui se gendarme et exige du Premier ministre Ehud Barak le libre passage pour le blessé.
En France commence, d’abord en réanimation, la longue reconquête d’une santé qui ne reviendra jamais. Puis un combat pour désigner les coupables et obtenir leur sanction. Une plainte pour «tentative d’homicide volontaire» est déposée devant le TGI de Paris.
Pour prospérer l’enquête exige la coopération du gouvernement israélien, l’application d’une convention d’entraide signée en 1959.
Résultat? L’affaire va en rester là. Si les policiers experts et magistrats français ont pu faire une partie de leur travail en France, rien n’est possible avec le régime de Tel Aviv puisqu’après plus de trois années de silence ce dernier refuse de coopérer : le dossier militaire concernant ce tir est «secret».
En 2011, faute de pouvoir avancer, le TGI rend une ordonnance de «non-lieu». William Bourdon, l’avocat du reporter, se retourne alors vers le Fonds de Garantie dont la mission est de soutenir financièrement les victimes. Pas de chance pour le journaliste, cet organisme pourtant placé sous tutelle de l’état, refuse de prendre en charge le dossier du blessé de Ramallah.
Approuvant son point de vue en première instance, la justice estime que «donner raison au reporter reviendrait à s’ingérer dans la politique d’Israël, un état souverain».
Exprimé d’une façon brutale, cet arrêt nous dit que tirer sur un journaliste peut être une mission qu’on ne doit pas contester. En septembre 2015, devant la Cour d’appel de Paris, les juges retrouvent leur bon sens. Est entériné le fait que Jacques-Marie Bourget est bien une victime civile qui justifie de l’assistance du Fonds de Garantie.
Hélas l’arrêt est rédigé avec une ambiguïté qui motive une décision de cassation.
Quatrième mi-temps le 21 juin dernier. Cette fois la Cour d’appel de Paris, de composition différente, vient confirmer le statut de victime du journaliste.
Elle le fait en termes clairs, forts et exemplaires. On peut dire courageux puisque la critique d’un acte commis par un agent israélien – même au simple niveau de la technique juridique- exige en France volonté et indépendance.
L’arrêt du 21 juin nous dit :
«Si le Fonds de Garantie est en droit de soutenir que le militaire qui agit en zone de combat ou de maintien de l’ordre bénéficie d’une cause objective d’impunité qui opère “in rem”, et d’invoquer l’existence d’un fait justificatif inhérent à l’acte de guerre, c’est à la condition que le militaire ait agi dans le respect des règles du droit international humanitaire, notamment des conventions de Genève relatives à la guerre, qui encadrent l’usage de la violence inhérente aux conflits armés, et protègent les populations civiles et les personnes qui ne participent pas aux combats.
Selon l’article 79 du Protocole additionnel I du 8 juin 1977 -entré en vigueur à l’égard de la France le 24 août 1984- aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux :
«Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé sont considérés comme des personnes civiles et protégés comme telles.
Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne,de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, deleurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique».
«Il découle de ces éléments que l’auteur du tir a commis un acte grave, qui n’était pas absolument nécessaire en l’état de ces circonstances de fait et qu’il a agi en violation des règles du droit international humanitaire.
… Que le soldat israélien – qui n’a pu être identifié – n’ait pas eu l’intention de blesser un journaliste, cette circonstance n’a pas d’effet exonératoire dès lors que l’auteur du tir a pris sans motif légitime, à tout le moins, le risque d’une maladresse.
Il a commis un acte manifestement illégal qui le prive du fait justificatif inhérent à l’acte de guerre et spécialement, de la cause d’impunité prévue par l’article L 122-4 du code pénal.»
Bon ! Eh bien voilà. Dix-huit années de douleur, de lutte, d’abandon des «confrères» et des médias outre le SNJ et la Fédération Internationale du Journalisme, pour atteindre cette décision exemplaire qui permet à Jacques-Marie Bourget de «faire son deuil».
Celui de ce que sa vie n’a plus jamais été. Mais, si les mots sont dits, la partie n’est pas jouée. Alors qu’au travers du Fonds de Garantie c’est l’état qui s’exprime, ce dernier a déjà menacé de se pourvoir, une fois encore, dans le ping-pong de la cassation.
Voulant ignorer par ce recours scélérat qu’au-delà du cas du grand reporter, cet arrêt de la Cour d’appel fait jurisprudence et s’applique à l’ensemble des journalistes victimes de crimes ou de violences en zone de conflit. Dans un monde médiatique dont la doxa est d’être solidaire de ceux qui sont victimes des violences de notre temps, il serait logique que les journalistes entrent aussi sous l’aile de la République.