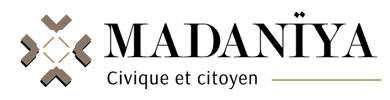Dernière mise à jour le 15 septembre 2014
I. Le processus ayant abouti à la proclamation du Califat
Dimanche 29 juin 2014, premier jour du mois sacré du Ramadan, le califat de Da’ech fut proclamé sur l’ancien territoire des deux premiers empires arabes (Omeyade en Syrie et Abbasside en Irak). Au-delà de la portée symbolique de cet événement dans l’ordre religieux et politico-historique mondial, ce califat a radicalement bouleversé les données de l’échiquier régional.
Faut-il y voir l’aube d’une nouvelle renaissance panislamique, la nostalgie d’une grandeur révolue ou une pathologie passéiste ? Quoi qu’il en soit, dans la foulée de l’irruption des djihadistes sunnites sur la scène irakienne, l’instauration de ce prétendu cinquième califat de l’histoire musulmane a démantelé la cohabitation et la coopération djihadiste, accéléré le processus d’indépendance du Kurdistan irakien et, de surcroît, donné aux djihadistes sunnites accès aux gisements pétroliers.
Ces trois facteurs font planer un sérieux risque de partition de l’Irak et placent désormais ce pays à l’épicentre du conflit transrégional ; une migration intervenue après 4 ans de guerre en Syrie en ce que les gages territoriaux engrangés par Da’ech en Irak devraient constituer dans son esprit la revanche à ses revers successifs en Syrie.
Sur le plan rituel, le nouveau calife Ibrahim, de son nom de guerre Abou Bakr al-Baghdadi, cumule avec autorité pouvoir politique et spirituel sur l’ensemble des musulmans de la planète. Une posture qui le hisse au rang de supérieur hiérarchique du Roi d’Arabie, le gardien des lieux saints de l’Islam (la Mecque et Médine), d’Ayman Al Zawahiri, le successeur d’Oussama Ben Laden à la tête d’Al Qaida ainsi que du président de la Confédération mondiale des oulémas musulmans, Youssef al-Qaradawi. Une belle audience califale en perspective !
Si les précédents califats ont eu pour siège des métropoles d’empire – Damas, Bagdad, Le Caire (Fatimide) et Constantinople (Ottoman) –, le dernier venu a établi son pouvoir dans une zone quasi désertique à proximité toutefois des gisements pétroliers générateurs de royalties, les nerfs de sa guerre. De même, sur le long chemin du djihad, des Émirats islamiques ont été institués au Kandahar (Afghanistan), à Falloujah (Irak) et au Sahel, mais aucun n’a jamais songé à choisir Jérusalem pour capitale. Le djihad en tant que libération des lieux saints est bien loin des préoccupations de ces joyeux guerriers.
Ce bouleversement symbolique dans la hiérarchie sunnite sur fond d’exacerbation du caractère sectaire de la rivalité sunnite-chiite a modifié sensiblement les termes du conflit : la surenchère intégriste des islamistes sunnites a opéré un retournement de situation qui a placé en porte-à-faux leurs bailleurs de fonds, principalement l’Arabie Saoudite, qui pourrait pâtir de ce débordement rigoriste et en payer le prix au titre de dommage collatéral.
Pour surprenant que cela puisse paraître, le califat de Da’ech a eu le grand mérite d’agir comme révélateur en ce qu’il a brisé les codes de la guerre asymétrique précédemment en vigueur et en ce qu’il a réussi en une opération éclair (un blitzkrieg), à réaliser en trois semaines la jonction entre la Mésopotamie et l’Euphrate. Chose que 40 ans de magistère baasiste, tant en Irak qu’en Syrie, n’ont pu accomplir à cause des guerres picrocholines entre les frères ennemis du Baas, Saddam Hussein et Hafez al-Assad.
En une vingtaine de jours, sous la bannière de Da’ech, les insurgés sunnites se sont emparés de larges pans de territoire dans le nord et l’ouest de l’Irak. Dans la pure tradition d’une charge de brigades légères, motorisées toutefois, mais sans armement massif, ni aviation ni drones, ils ont ainsi ouvert dans l’ouest du pays une voie vers la Syrie en s’emparant du poste-frontière de Bou Kamal, pendant de celui d’Al Qaïm qu’ils contrôlent déjà, à la faveur d’une entente locale avec Al Qaida.
Curieux cheminement, au passage, que celui des baasistes irakiens (une des composantes de l’ISIS) : plutôt que d’opposer un front idéologique avec leurs frères baasistes syriens, ils ont rallié leur ancien bourreau saoudien, la caution arabe et musulmane de l’invasion américaine de l’Irak, abandonnant à son sort le pouvoir syrien, qui fut leur plus ferme soutien dans la guérilla antiaméricaine en Irak et s’attira à ce titre les foudres de Washington par la « Syrian Accountability Act », en 2003.
Depuis la proclamation de l’État islamique d’Irak et en Syrie (Da’ech), l’auteur de ce rapport s’est appliqué à procéder à une analyse de ce phénomène en profondeur avec toute l’objectivité et la rationalité requises, selon une grille de lecture intégrant les critères de démocratie civile, sans concession ni complaisance à l’égard de toute atteinte aux droits de l’homme et à la dignité humaine tant il est vrai qu’« il n’y a pire sourd que celui qui ne veut entendre ».
En mars 2013, l’auteur a soulevé la question de l’enlèvement de deux évêques en Syrie auprès d’un opposant syrien drapé de démocratie. Sa réponse, sidérante, consistait à imputer cet acte crapuleux à un « groupement tchétchène dépêché en Syrie par les services russes opérant en sous-traitance auprès des services de renseignements syriens ». Ah, la perversion des esprits…
« Cet entretien fut le dernier entre nous. Je n’ai plus jamais voulu le revoir. Que dire, en effet, quand des personnalités accréditées de l’opposition syrienne au sein du Groupe des amis – ennemis – de la Syrie assurent sans sourciller qu’Abou Omar al-Shishani est un agent des services russes, feignant d’ignorer ou ignorant tout simplement qu’il avait combattu les Russes en Géorgie avant de migrer vers la Syrie. D’autres se vantaient de pouvoir anéantir Da’ech en 48 heures. »
Un témoignage terrifiant en résonance avec les analyses de la chaîne saoudienne Alarabia. Des propos qui révèlent, en contrepoint, le degré de superficialité des analystes, leur avilissement moral, leur appétit immodéré pour les subsides, adoubés néanmoins malgré ses handicaps comme « représentant unique du peuple syrien » par un groupe de six parrains régionaux et internationaux (Arabie Saoudite, Qatar, Turquie, États-Unis, France, Grande-Bretagne). Un clan de peu de poids comparé à celui d’en face, résolument engagé dans le djihad et dans son projet d’édifier un califat sunnite, représentant unique sur terre.
Paradoxalement, les débats les plus pertinents se sont déroulés au sein de Da’ech, de Jobhat An Nosra et d’Ahrah As Sham, parce qu’ils avaient été nourris de l’expérience d’Al Qaida dont ils furent formés dans le même moule djihadiste. De sorte que ni Abou Mohamad al-Joulani[1] ni Abou Marya al-Qahtani n’étaient en mesure de mettre en cause les sources de financement de leurs rivaux ou de les accuser de servitude à l’égard des services syriens ou irakiens.
L’insistance du régime syrien à privilégier l’option militaire et sécuritaire, de même que l’inclination du régime irakien à emprunter la même voie, en superposition à la faillite de la politique des puissances régionales et occidentales sur ce dossier – activement relayés d’ailleurs par des Syriens de petite envergure et des entremetteurs animés par la haine –, ont tué dans l’œuf un soulèvement civil populaire prometteur. Au prix d’ailleurs de la destruction d’un pays et de la dislocation d’un peuple.
Alors que Robert Ford, émissaire spécial des États-Unis auprès de l’opposition syrienne off-shore, dissertait devant moi à en perdre haleine sur les relations entre les Unités de protection du peuple et le régime syrien, alors que la Turquie favorisait la commercialisation du pétrole prélevé frauduleusement en Syrie avec la caution de l’Union européenne, Da’ech avait déjà réglé depuis belle lurette l’épineux problème de la diversification de ses sources de financement. Le califat se dégageait par là une marge de manœuvre considérable pour l’autonomie de son pouvoir décisionnaire, y compris à l’égard de ses financiers salafistes pétro monarchiques, ses principaux pourvoyeurs en hommes et en argent. Et pendant que les dirigeants de la coalition off-shore s’égosillaient à réclamer des armes performantes pour combattre plus efficacement le régime syrien, Da’ech se ravitaillait directement sur les stocks d’armes de Raqqa et de Mossoul.
Quand le Qatar et l’Arabie Saoudite ont voulu se doter de groupements spécifiques de djihadistes pour les besoins de leur politique, Da’ech a décidé d’engager un combat frontal, une guerre ouverte contre les groupements rivaux en gestation, sans le moindre égard pour leur ancienne fraternité d’armes.
Les liquidations extrajudiciaires de dirigeants djihadistes opérées par le régime syrien sont infinitésimales par rapport aux pertes subies du fait des guerres intestines inter-djihadistes puisque les uns et les autres étaient avisés des forces et faiblesses des groupements rivaux et agissaient en conséquence. Les membres d’une même famille sont mieux avertis des problèmes en son sein, quand bien même les rapines des brigands ont révélé bon nombre de faits qu’ils s’étaient évertués à dissimuler.
A – Les mérites de Da’ech
Le mérite de Da’ech est d’avoir mis à nu les légendes préfabriquées par la chaîne Aljazeera, depuis la première opération du Front An Nosra contre la base aérienne d’Alep couverte par Ahmad Zeidan, tout comme la sanctification médiatique d’Abou Mohamad al-Joulani à laquelle s’est livrée Tayssir Alouny, de même que l’occultation par la chaîne qatarie de tous les crimes commis par An Nosra dans une pitoyable réédition de la couverture du conflit d’Irak.
Le fait qu’Abou Mohamad al-Joulani, le chef de Jobhat An Nosra en personne, dénonce la dilapidation d’un milliard de dollars par les djihadistes eut un effet catastrophique sur le cours de la bataille et un impact désastreux sur l’opinion : des dizaines d’enfants mouraient alors de faim dans les camps de réfugiés, et d’anciens marxistes jadis respectables soutenaient, au même moment, sans sourciller, la pureté de l’engagement des membres d’An Nosra et leur désintéressement.
Da’ech a démasqué le discours populiste des Frères musulmans initié en premier lieu par Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie, et repris par Sayyed Qotb et Youssef al-Qaradawi, lesquels soutenaient en chœur que l’Islam est tout à la fois une religion, une idéologie, un État, une loi, un mode de vie, une science, une morale, une identité, une nation, une politique, une économie, une armée et des services de renseignement. Ces affirmations péremptoires selon lesquelles « l’Islam est la solution » engourdissaient l’opinion alors que la confrérie exerçait son emprise sur la société et se permettait ce qu’elle ne permettait pas aux autres. Autrement dit, elle s’octroyait des libertés qu’elle n’autorisait pas aux autres – avec tout ce que cette idéologie a servi de prétexte et de justification à l’extrémisme en Syrie et en Irak.
Da’ech nous a ainsi épargné la lecture de dizaines d’ouvrages sur la notion de « retour vers le passé » en vue d’édifier un califat sur le modèle de la prophétie, en ce que son comportement a traduit concrètement sur le terrain le concept de la Jahiliya – c’est-à-dire l’ère préislamique, préconisée par Sayyed et Mohamad Qotb –, faisant prévaloir sa propre interprétation des faits dans un sens favorable à ses thèses, pour en faire la justification de ses crimes, ses turpitudes et leur comportement rétrograde.
Da’ech a également démasqué le subterfuge consistant à instrumentaliser la religion en tant que stratégie de conquête de pouvoir. Jusque-là, cette stratégie était demeurée dans l’ordre implicite et indicible. Da’ech – et non un intellectuel critique – a fait voler en éclat le sacro-saint principe de gouvernance divine (alhakimyya) en traduisant in situ la notion d’obscurantisme en vigueur dans l’ère préislamique. Alors même que le califat a rétabli la pratique de l’ostracisme au sein des sunnites, et a transformé la sauvagerie et la violence en mode de vie.
Au fil des événements, le constat est amer : comment, au nom de la Révolution, avoir sapé les fondements de la révolte en imputant la totalité des responsabilités au régime alors que les fautes s’accumulaient, au point que la réponse était toujours identique, inlassable leitmotiv : « La faute au régime ». Le disque rayé a continué de diffuser sa rengaine, sans que nul ne se soit donné la peine de reconsidérer sa position, de procéder à un réexamen de son comportement.
Pathétique inversion, le fait décisionnaire concernant la Syrie n’est pas demeuré aux mains des Syriens. Il fut cédé à autrui pour que soient forgées les décisions relevant normalement de la volonté syrienne. L’armement de la Syrie a été confié à des non-Syriens, à des pouvoirs établis hors du territoire national aux contours flous.
Ma mise en garde, en date d’août 2011, était pourtant empreinte d’une grande clarté : « La militarisation de l’opposition entraînera inéluctablement la radicalisation et la confessionnalisation du conflit. » Notre proposition d’établir une cloison hermétique entre les partisans de la transformation démocratique et les partisans des projets obscurantistes suscita un tollé.
Un des nombreux autres mérites de Da’ech réside dans sa parfaite connaissance des Mouhajirines (les migrants de la guerre djihadiste), de leur niveau intellectuel et politique limité de même que de leur conscience religieuse, leurs problèmes personnels et leurs objectifs qui en ont fait des êtres à vocation suicidaire. Da’ech a traité ses migrants à la manière du bétail, leur offrant en guise d’appât l’argent et le sentiment de puissance. L’objectif était simple : viser la tête pour que le troupeau suive, et les meilleurs signeront leur ralliement à notre cause.
Il est indéniable que les anciens officiers de l’armée irakienne ont joué un rôle primordial dans le recrutement des volontaires et l’enrôlement d’étrangers dans le combat pour l’édification du califat.
B – Les copulations bâtardes
L’alchimie fusionnelle entre les anciens officiers irakiens de l’armée baasiste et Al Qaida est le fruit d’une copulation bâtarde opérée dans les prisons américaines d’Irak. Au commencement était donc Al Qaida : une organisation militaire et politique dotée d’un grand potentiel, bénéficiant d’un soutien américain et pétro monarchique et fortement engagée dans une guerre contre l’occupant soviétique en Afghanistan. Ce conflit fait l’effet d’un aimant sur l’ensemble des Moudjahidines de la planète, et produit un effet fédérateur en ce qu’il a donné la possibilité à des groupuscules salafistes opérant nationalement, à petite échelle sur un plan local, d’accéder au rang de forces de frappe transfrontière.
Point n’est besoin de revenir sur les points soulevés dans notre précédent ouvrage (Le Salafisme, les Frères musulmans et les droits de l’homme). Il importe toutefois de rappeler le halo de sacralité qui entourait quiconque se réclamait alors du djihad contre les athées, les communistes, les infidèles et les dictateurs.
La fin de la guerre d’Afghanistan et l’implosion de l’Union soviétique ont entraîné la fin du blanc-seing djihadiste octroyé par les commanditaires à leurs commandités en ce qu’il importait pour les États parrains de se prémunir des répercussions de cet engagement sur leur sol. De « Moudjahidines de la Paix », les voilà réduits au statut d’indésirables, lesquels n’entendaient pas, loin de là, assumer la fonction de victimes sacrificielles.
Ces nouveaux indésirables s’étaient forgé une légende, et leurs tuteurs n’étaient plus en mesure d’en faire abstraction. Encore moins de les contenir. Ces djihadistes avaient la conviction ancrée qu’ils avaient mis fin à la guerre froide en même temps qu’à la présence communiste en terre d’Islam. La fin du communisme ne signifiait pas la fin du djihad. Au fil des alliances et au gré des guerres – Tchétchénie, Bosnie, Algérie –, les vétérans d’Afghanistan se sont éparpillés, en fonction des soutiens dont ils bénéficiaient ou des refuges dont ils disposaient.
Les services pakistanais, les premiers, se sont employés à restaurer leur influence en Afghanistan en soutenant les talibans pachtounes, parallèlement à une démarche similaire d’Oussama Ben Laden visant à regrouper les anciens salafistes djihadistes de la guerre antisoviétique en Afghanistan, sur le terrain de leurs exploits et de leur légende, considérant le pays des talibans comme un terrain d’entraînement propice et un lieu sûr pour leur refuge.
La société irakienne, dans toutes ses composantes, était la plus étrangère à la question afghane, ayant été impliquée par ses gouvernants, volens nolens, dans des guerres coïncidant avec la séquence afghane (guerre irako-iranienne de 1979 à 1989, invasion du Koweït en 1990). Ployant sous le joug des sanctions internationales, elle a ainsi été épargnée de la jouissance du tourisme djihadiste.
À dire vrai, les salafistes et les Frères musulmans ne constituaient pas une priorité pour Saddam Hussein puisque le pouvoir irakien à cette époque était davantage polarisé par les manœuvres américaines concernant son éventuelle possession d’armes de destruction massive. Les Frères musulmans et les salafistes ont ainsi pu s’installer en Irak à la faveur du désordre consécutif à l’invasion américaine du pays, en 2003, et des décisions désastreuses de Paul Bremer, premier proconsul américain en Irak, concernant le démantèlement des forces armées et l’éradication du parti Baas.
Ces deux mesures qui ont sapé le fondement de l’État irakien ne se sont heurtées ni à l’opposition des Kurdes, qui sont parvenus à préserver leur force d’autodéfense (les Peshmergas), ni à celle des partis chiites qui y ont vu l’occasion de reconstituer la nouvelle armée irakienne sur la base de l’adjonction-injection des anciens combattants chiites basés en Iran, auparavant engagés dans la guerre irako-iranienne, du côté de l’Iran.
À ce titre, les forces d’invasion américaines assument une responsabilité majeure dans la création des conditions objectives à la constitution de vastes regroupements armés hors de leur contrôle en ce que les États-Unis se sont appliqués à éradiquer et à démanteler méthodiquement tout ce qui avait un rapport direct ou indirect avec l’ancien pouvoir baasiste irakien. En un mot, à vider l’appareil d’État de sa substance.
Les chiites avaient pour objectif principal de faire cesser l’injustice dont ils avaient été l’objet sous l’ancien régime. Ils n’étaient porteurs d’aucun programme de portée nationale, d’aucun projet de citoyenneté nouvelle. Ils ont privilégié une conception communautariste du pouvoir d’État, avec ses implications en ce qui concerne la répartition des postes selon des critères confessionnels à l’effet de générer un fanatisme clanique à fondement religieux.
Le bagage intellectuel d’Abou Mouss’ab al-Zarkaoui, tant sur le plan politique qu’idéologique, ne le prédisposait pas à un rôle dirigeant dans la lutte contre les forces d’occupation. Par substitution, phénomène classique en psychanalyse, il a compensé son inconsistance intellectuelle par une férocité militaire dans les combats.
L’homme se vivait comme détenteur de la vérité absolue, animé de la capacité d’imposer cette vérité à son entourage et habile à masquer ses faiblesses en diabolisant ses rivaux. Dans cette perspective, il a réactivé l’ancienne stigmatisation des chiites en remettant à l’honneur le terme de « renégat » pour les désigner de ce qualificatif et leur faire assumer la responsabilité de l’état de dégradation de l’Irak, de l’éloignement des sunnites de leur religion et… du pouvoir !
Cette stratégie rudimentaire lui a permis de mobiliser les frustrations comme levier de recrutement et de mener à bon compte des opérations aussi bien contre des objectifs civils que militaires, les enfants que les adultes, les femmes que les hommes. Toute pensée qui ne se réclamait pas du salafisme djihadiste était considérée comme relevant de la traîtrise.
Un quart de siècle de bouleversements dramatiques – une guerre de 10 ans contre l’Iran, suivie de l’invasion du Koweït, de deux guerres, d’une importante coalition internationale sur fond de blocus permanent pendant 20 ans – a profondément modifié le paysage irakien, opérant un bouleversement radical du schéma mental et des repères de la société, donnant libre cours, dans une lutte pour la survie individuelle, à l’exacerbation des antagonismes ethnico-religieux, voire à un début de sauvagerie.
Pour les besoins de sa cause, l’administration américaine a jugé bon de promouvoir « ennemi numéro 1 » le groupe d’Abou Moussab al-Zarkaoui. Toutefois, focaliser l’attention sur ce groupe djihadiste a eu pour effet secondaire de marginaliser les autres groupes de résistance aux yeux de l’opinion irakienne et arabe, et de reléguer au second plan les crimes politiques, administratifs et militaires qui se commettaient à ce moment-là sur l’ensemble du pays.
L’éradication de l’armée irakienne d’officiers confirmés, avec la privation de salaires qui s’est ensuivie, a poussé bon nombre de gradés à rallier les groupes les plus fanatiques et les plus résolument hostiles au processus de refondation de l’État irakien selon le schéma américain.
La coordination entre Al Qaida et ce groupe d’officiers marginalisés a commencé très tôt. La raison en est simple : le groupement djihadiste souhaitait tirer profit de l’expertise de ces officiers rompus aux combats, désormais désœuvrés mais dotés d’une expérience certaine (tant en ce qui concerne la topographie des zones de déploiement américain que par leurs réseaux de solidarité. Le rapprochement idéologique est intervenu à l’occasion de leur séjour commun dans des camps américains. L’alchimie fusionnelle entre les anciens officiers irakiens de l’armée baaasiste et Al Qaida est le fruit d’une copulation bâtarde opérée dans les prisons américaines d’Irak, à l’ombre de l’occupation occidentale de l’Irak.
Da’ech relève de la « génération de la triplette maudite » traumatisée par les guerres successives de Saddam Hussein, par le châtiment collectif infligé à sa population par le blocus international de l’Irak – l’un des pires de l’histoire contemporaine – et, enfin, par la présence américaine, la plus idiote occupation de l’histoire américaine.
Cette conjonction maléfique de trois éléments, schéma identique à celui vécu au quotidien par les habitants de Gaza, a généré au sein de la population irakienne un fort sentiment de nihilisme. L’État irakien se retrouvait en effet réduit à un État précolonial de régression, faisant voler en éclat tout lien de solidarité sociale et de cohésion nationale et tout lien avec la modernité. La modernité se réduisant ici aux transactions d’armes, à l’acquisition de matériel de torture, à la dilapidation des richesses nationales, physiques et humaines, et à l’arbitraire du pouvoir.
Le lourd endettement public aura été la résultante première de cette civilisation. Ni le pétrole ni l’important arsenal militaire dont disposait le pays n’a pu suggérer aux Irakiens l’idée qu’ils appartenaient à cette civilisation, et encore moins susciter en eux le sentiment d’éprouver une certaine forme de dignité humaine. Bien avant que ne se réalise cette triangulation maudit, le poète irakien Badr Chaker al-Sayyab avait rédigé à ce propos un poème intitulé « La prostitué aveugle ». Au terme de cette séquence surchargée d’épreuves pour les Irakiens, la culture s’est dissipée, et la presse exténuée a laissé place à un désert culturel. Les mots sont devenus impuissants à décrire la catastrophe dans laquelle vivait humainement la société irakienne.
Lors de ma mission en Irak, en juin 2003, je devais rencontrer le représentant des Nations unies en Irak, Sergio Mello, tué par la suite dans un attentat. Le chauffeur qui me conduisait à mon rendez-vous m’interpella en ces termes : « Les Nations unies ont participé au meurtre d’enfants de mon village, par la faim et la maladie. Sera-t-elle en mesure d’expier, un jour, les péchés qu’elles ont commis à l’encontre de notre peuple ? » Il faisait clairement allusion à l’embargo imposé par l’ONU à l’Irak dans la décennie 1990-2000.
Ce chauffeur n’était pas originaire de la province sunnite d’Al Anbar mais d’un village chiite du sud de l’Irak. Il s’est porté volontaire pour me convoyer à Falloujah, le fief sunnite, peu de temps avant les massacres commis par les forces d’occupation américaines. Il vivait au jour le jour pour assurer prioritairement la subsistance de ses enfants, sans perspective quant à la fin de son cauchemar, sans illusion qu’il prenne d’ailleurs fin un jour, et sans la moindre idée non plus de la date à laquelle il verrait le bout de ce tunnel obscur dans lequel s’était engagé l’Irak depuis la fin de la décennie 1970.
Le plus grand crime a sans doute été commis par la classe politique irakienne : toutes ses composantes auront constamment recherché des boucs émissaires à ses abus et ses dérives. Il en a été ainsi avec l’opposition qui s’est engagée dans une politique vindicative, dès son retour au pays, accusant les réfugiés palestiniens d’avoir soutenu Saddam Hussein avec les mesures de rétorsion inhérentes %C