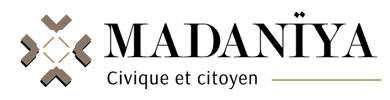Dernière mise à jour le 17 septembre 2014
I. Retour au point de départ
En 2005, 4 ans après les événements du 11 septembre 2001 et les attentats qui en ont découlé dans des villes européennes, j’ai tenté d’aborder la problématique de l’autodestruction par autrui, conventionnellement qualifiée de phénomène « kamikaze » ou de phénomène des « bombes humaines » dans le langage journalistique.
Je me suis rendu compte que cette approche, à tout le moins sa perception, doit être reconsidérée. En premier lieu parce que la connaissance de soi et d’autrui s’est considérablement modifiée avec l’entrée en scène du mouvement salafiste djihadiste dans un conflit ouvert contre l’altérité, dans la double perception de ce terme, « l’autre en tant qu’occupant » et « l’autre relevant d’une appartenance différente ».
L’Irak a apporté la preuve – et en a donné un exemple à son échelle – que les dangers de l’anarchie sont infiniment supérieurs aux dangers résultant des transformations d’un pays. La liquidation de l’État irakien par les forces d’occupation américaines a introduit trois éléments essentiels qui ont fait voler en éclat les attributs fondamentaux de l’État et son rapport à la société, indépendamment de la nature du projet étatique :
- la fin du monopole de la violence organisée, un des attributs fondamentaux de l’État, une donnée consubstantielle à la constitution de l’État depuis l’ère préislamique, il y a 3 000 ans ;
- la fin du monopole du discours prescripteur de l’État, du fait de l’absence de tout appui à ce discours et de l’apparition des médias transfrontières ;
- la fin du rôle répartiteur de richesses de l’État en ce qu’il a cessé d’être la principale source de financement et de redistribution de l’argent politique du pays (particulièrement dans les pays en crise).
La fin de ce triple monopole – sur l’espace hertzien, les armes et l’argent – a bouleversé la conception traditionnelle de l’État moderne, tant sur le plan politique que sur le plan civil, en plus de « déblayer le terrain », de laisser transparaître des troubles profonds qui ont laissé leur marque sur la personnalité humaine, brisant les règles de base des relations interhumaines.
Si l’échec de l’occupation américaine en Irak a fait reculer le virus de « l’interventionnisme étranger positif » qui avait gagné les esprits de bon nombre d’opposants arabes, les mouvements populaires pacifistes survenus en Tunisie, au Bahreïn et en Égypte, en 2010-2011, ont ouvert de nouveaux horizons quant aux possibilités de transformations politiques de la société par l’intérieur de la société elle-même.
L’euphorie qui s’est emparée du monde à l’issue du « succès » de l’expérience libyenne a remis d’actualité, en une belle symphonie arabe et occidentale, la rengaine d’une nécessaire « intervention étrangère pour se débarrasser de la dictature ».
Les souverains arabes n’ont pas ménagé leurs efforts pour forger des fatwas visant à donner un blanc-seing à l’OTAN, le gratifiant, pour ce faire, du titre de « sauveur ». Beaucoup, consciemment ou inconsciemment, ont veillé à appliquer le schéma libyen à la Syrie. Comme il était alors risible de lire certaines pétitions, comme celle de cette instance qui s’était baptisé Les Oulémas de la nation et qui proclamait son soutien au Conseil transitoire syrien, transposant à la Syrie la dénomination en vigueur dans l’instance libyenne… alors même que le Conseil national syrien s’était bien gardé de copier la Libye pour éviter toute accusation d’imitation.
L’instance des oulémas exhortait toutes les forces à intervenir en vue de sauver le peuple syrien. Lui emboîtant le pas, le mufti du Qatar, Youssef al-Qaradawi, ne s’est pas contenté, lui, de supplier l’OTAN d’intervenir en Syrie. Allant plus loin, il a invité tous ceux qui étaient en mesure de faire le djihad à se rendre en Syrie pour soutenir le combat du peuple syrien. Un appel réitéré par des dizaines de pseudo-cheikhs salafistes d’Arabie Saoudite, du Koweït, d’Égypte, de Libye et de Tunisie.
L’objectif n’était plus de tuer dans l’œuf le soulèvement populaire en Syrie, mais de transformer ce pays en un cimetière où enterrer le moindre indice d’une quelconque manifestation spirituelle et mentale d’une nation qui aurait perdu tout contact avec le monde et l’humanité du fait de la perspective grisante qui s’offrait à lui : l’usage inconsidéré de l’apostasie. Cette arme, utilisée comme une drogue grisante au point qu’on parle parfois d’« opium de l’apostasie », à l’effet galvanisant certain, est équivalent par ses effets à la consommation de l’opium, aidant à la recherche d’un paradis éternel.
Nous eûmes alors droit à la séquence des « combattants pour la liberté » (selon l’expression de Bernard-Henri Lévy et de Laurent Fabius), amplifiée par la thématique de « l’inéluctable recours à la violence dans une révolution » soutenue par d’autres « penseurs ». Puis le brouillard s’est dissipé, offrant le spectacle de groupements rigides, pétrifiés, accablés des complexes du passé et du présent, débattant sur « le monde et l’au-delà » dans l’attente du Mehdi [1] collectif qui restaurera le Royaume de Dieu, souillé auparavant par ses successeurs.
Depuis les explosions du périphérique sud de Damas, en décembre 2011, jusqu’à nos jours, le débat est frappé de dichotomie, dominé par des démarcations grossières et des binômes simplistes (Dieu/le diable ; le camp du bien/le camp du mal), non seulement dans le clan des Abou, mais également chez beaucoup de non-musulmans, faisant supporter à la dictature l’entière responsabilité de ce zèle néophyte dans le domaine religieux.
Nul ne s’est préoccupé de déterminer le début et la fin du tunnel. Quiconque s’est hasardé à tirer la sonnette d’alarme a été assailli d’un flot d’accusations allant de « suppôt de la dictature » à « traître à la révolution ».
Cette profusion de mensonges politiques et médiatiques s’est retournée contre ses auteurs. Des dizaines, voire des centaines de fatwas invitaient les jeunes à effectuer le djihad en Syrie en une avalanche continue. Ce zèle jurisprudentiel sera néanmoins interrompu par l’aviation israélienne dans ses raids contre les populations civiles de Gaza, en juillet 2014, en plein mois de Ramadan, le mois sacré du jeune selon le calendrier musulman, réduisant au silence ces zélotes, alors que les takfiristes continuaient à démolir les sanctuaires et les lieux de culte et poursuivaient leur œuvre de décapitation en terre d’Islam.
II. La mondialisation et la contre-mondialisation
Dans leur ouvrage commun Reason and Violence a Decade of Sartre’s Philosophy, Laing et Cooper [2] estiment que la nécessité dialectique commande de confronter l’expérience à la réalité en tout état de cause pour qu’un fait soit accepté mentalement. La dialectique détient une force positive pour tout observateur de l’intérieur du système en ce qu’un rapport s’instaure entre l’esprit dialectique et le réel ; entre une vision de l’intérieur du système de pensée et l’extérieur, pour découvrir la dimension mondiale de toute manifestation de même que la possibilité de suivre en évolution en dehors de son champ spatio-temporel.
La question qui se pose continuellement à nous est la suivante : déterminer quelle est la part en nous de l’inné et de l’acquis, du biologique et du social, du psychologique et du juridique, la part de la conviction du politique, de la continuité et de la rupture. L’ancien et le nouveau dans le phénomène de la violence, de l’agressivité, ou encore dans cet agrégat étonnant que l’on désigne du vocable de sauvagerie.
Le dynamitage du drugstore de Paris, en 1974, ou celui du métro souterrain londonien, en 2005, relèvent-ils d’actes d’une même nature en ce qu’ils consistaient en des actions contre des civils ? La violence et l’agression ont-ils la même signification en droit et en psychanalyse ? Y aurait-il des critères distinctifs de qualification à ces deux phénomènes en voie de généralisation, en voie d’extension horizontale, dans un monde globalisé ?
Ces questions méritent une réflexion collective et approfondie et ces lignes n’ont pas la prétention d’apporter une réponse définitive à un sujet par essence complexe. La problématique méritait toutefois d’être soulevée, ne serait-ce que pour secouer la société du spectacle mondialisée engourdie dans sa torpeur mentale.
« Il est difficile d’imaginer des gens heureux ignorant la violence et l’agressivité », estime pour sa part Sigmund Freud [3]. Cette sentence définitive met un terme au débat entre psychanalystes. Il n’existe pas en effet de consensus quand il s’agit de définir la violence ou l’agressivité. Mais, d’une manière générale, et dans la lignée de Philippe Jeammet [4], on peut considérer la violence comme ayant pour fonction fondamentale de protéger l’ego, de le vider de ses surcharges internes.
Prise dans ce sens, la violence peut se dispenser de rancune et de haine, tandis que l’agressivité constitue un acte prémédité pour briser l’autre, pour détruire celui considéré comme autre [5]. Deux éléments constitutifs de l’agressivité sont à relever : une intention préméditée de porter tort et la volonté de faire mal, de perturber sa cible en procédant par exemple à un vol ou à la démolition d’objets revêtant une certaine importance pour l’agressé. Dès lors, M. Bruch parle en tel cas d’une prédisposition permanente à attaquer autrui, avec intention de démolir et, en tout état de cause, d’une riposte imprévisible [6].
Un autre courant de pensée, illustré par Antony Store, plaide pour une « agressivité nécessaire » en écho au constat d’un autre de ses collègues, Bastin, qui considère l’agressivité comme « un comportement vital d’une extrême positivité ». Jean-Marie Muller avance quant à lui que « l’agressivité est tout ce qui porte atteinte à la dignité de l’homme. Tout ce qui est en mesure de détruire la personnalité de l’autre ». Développant une thèse voisine à celle d’Edgar Wolff, auteur d’Instinct sexuel et agressivité, il considère que la violence est un « degré supérieur d’agressivité » et de « dangerosité en ce que la destruction de la personnalité peut impliquer des agressions physiques et corporelles, et s’accompagner de pressions et d’humiliations »[7].
Ce débat n’a pas valeur universelle. Il est même parfois difficile de le dégager du créneau des institutions culturelles occidentales, où il occupe une place de choix, et de le subdiviser en spécialité, en trouvant des prolongements conceptuels dans les sciences sociales, la philosophie et le droit. La relativité s’impose comme une nécessité dans la connaissance du sujet, dans le décryptage du phénomène, dans les déductions qui en sont faites.
La question fondamentale sous-jacente qui se pose est de savoir quel degré de violence peut être acceptable ou toléré dans une société ou un système de valeurs. Quel est le rôle de la justification politique ou idéologique à la violence ? Peut-on considérer comme valable le constat psychanalytique de la décennie 1970 sur le complexe sadico-mystique [8] expliquant la violence de cette période et l’appliquer à l’ère post 11 septembre 2001 ? Auquel cas, comment justifier la décapitation comme moyen de se rapprocher de Dieu ?
Peut-on se contenter de l’explication concernant une similitude de méthode en dépit des différences culturelles existant pour expliquer le dépassement de la violence et son basculement vers la sauvagerie humaine, rejoignant en cela l’ère prépaïenne de notre histoire, avec ou sans habit religieux ?
Peut-on reprendre à notre compte la notion de la violence de l’opprimé à l’identité volée, développée par Frantz Fanon, pour expliquer le phénomène de sauvagerie banalisant en quelque sorte des notions telles que agressivité, sadisme, vengeance et haine, auprès de ceux qui se considèrent comme le « meilleur groupe offert au Monde خير جماعة أخرجت للناس » (**) alors qu’ils ont ôté toute humanité et humanisme à leur comportement quotidien ?
Il est difficile de parler de la violence comme phénomène sociétal en l’absence d’une quelconque étude du terrain ayant favorisé son éclosion, sa force motrice, sa logique interne.
Le problème n’est pas tant que ma présence ait une signification en soi. Le problème est le vouloir vivre en commun dans un environnement dont l’hostilité à mon égard fait de moi son ennemi, dont la volonté de m’assigner par avance un rôle, un statut social et un avenir m’a privé de toute possibilité de procéder à une connaissance de soi, hors des directives édictées par lui, me conduisant à me soumettre à ces conditions. Réduit à un statut mineur, le rôle des minorités organiques, non pas tant en raison de l’importance numérique de ce lot mais en une reproduction des schémas moyenâgeux – soit avant le siècle des Lumières et les crises des temps modernes.
III. Sans frontières
En économie, si le renflouement de la monnaie présuppose une lecture à plusieurs niveaux, qu’en serait-il a fortiori des concepts ayant une incidence directe sur la vie quotidienne de l’être humain ? Quoi qu’il en soit, le faible en paiera le prix tant sur le plan de l’information, de la culture que de la politique.
Parler de crime d’agression et de crime de terrorisme est tout aussi difficile que ne l’a été le traitement du cas de la violence et de l’agressivité. Il en va de même du problème de la reconstitution psychologique par suite des séquelles de l’humiliation et des modalités d’adaptation dans une société défaillante.
Le stade ultime de la mondialisation a trouvé sa concrétisation avec la mondialisation des concepts concernant l’individu. L’importance a été mise, là, sur le consensus de Washington et son prolongement le consensus de Bruxelles reposant sur les six piliers suivants : la restructuration, la privatisation, le licenciement généralisé, la réduction des dépenses publiques, la libération des marchés et la liberté des opérateurs, considérant que ce dispositif est le plus apte à sauver l’humanité de la pauvreté, de la maladie, de l’arbitraire et de la corruption.
En outre, la mondialisation de l’économie s’est accompagnée d’une mondialisation des référents culturels. Le mot d’ordre « la mondialisation est la base » a favorisé la mutation des idéologies locales en ersatz d’une idéologie globale.
Sur un plan mondial et en phase de déclin de la civilisation occidentale, il n’est évidemment pas aisé de se doter d’instruments de domination. Bien que la renaissance européenne ait eu le mérite de refonder le monde sur un plan matériel et intellectuel, la « séquence » américaine ne portait pas en elle les germes d’un nouveau départ mais conservait des stigmates, les traces des vilenies des quatre siècles passées. D’où son traitement superficiel des phénomènes et des faits novateurs, et son penchant à mettre l’accent sur la célérité, en conformité avec la civilisation du fast-food.
Rien n’est plus profitable au complexe militaro-industriel que la mondialisation de l’état d’urgence, des lois de lutte contre le terrorisme, la délimitation du monde en deux camps antagonistes. L’opposition entre bien et mal constitue même plutôt le meilleur facteur de commercialisation et de marchandisation des produits, le souhait ultime de la mondialisation.
Au sein des décideurs de l’empire, nul ne conteste que la violence et la mondialisation sont jumelles. S’il est vrai que des questions telles que la critique, la dignité, la beauté, la croyance, la nature et la créativité peuvent ne pas figurer parmi les préoccupations du Président américain et de son assistant britannique, la gestion de la violence sur le plan interne et international constituent, en revanche et à n’en pas douter, leur préoccupation centrale.
Le dernier carré des concepteurs de la domination globale ne dispose plus du temps nécessaire pour draper ses actions d’un minimum de valeurs proclamées et reconnues. Pire, cette configuration le contraint à mener le combat en compagnie d’une dictature alliée contre une autre dictature au nom de la démocratie. La classe politique ne rougit pas à l’idée de financer ses campagnes politiques avec l’argent des noirs cafards. Le délitement de la notion de frontières aidant, elle a désormais le loisir de vendre des armes à un allié, lui-même en mesure de les rétrocéder à un groupement, sans hésiter publiquement et simultanément à réclamer le désarmement de ceux qu’il considère comme ennemi.
Est-il seulement possible d’assurer la liberté et l’arbitraire des marchés ainsi que la centralisation de la gestion de la violence dans un contexte marqué par la perte du sens des responsabilités au sein des gouvernants, sans que la civilisation occidentale n’en paie le prix en perdant de son éclat ? « Toute atteinte à la liberté génère la suspicion, l’injustice, le désintérêt envers le projet fondamental. Supprimer la spontanéité dans les dispositions légales et les mesures d’exception vicie le rapport à la liberté et nous contraint à tourner la page contre nous-mêmes, selon des règles préétablies au plus haut niveau », soutient le poète surréaliste égyptien Georges Henein dans son ouvrage De la liberté comme nostalgie et comme projet [9].
IV. Quelle différence ?
Dans un court poème chargé de signification, le grand poète Omar Khayyam interpelle son créateur en ces termes : « Si tu punis la faute en moi [sous-entendu moi qui suis ta créature], quelle différence existe-t-il alors entre toi et moi ? »
Ce vers résume bien le rapport dialectique entre grandes et petites puissances. Les tenants de l’instauration d’un droit de veto en faveur des grandes puissances au sein du Conseil de sécurité ont voulu conférer une prime à la puissance et un primat de la justice sur la force en ce que la force doit se conformer à la justice. Ce privilège, fondé sur une idée simpliste, a permis aux États-Unis de faire obstruction à 80 pour cent des résolutions onusiennes portant sur des affaires décisives concernant le sort des peuples, dans la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). Ce faisant, elle a placé l’organisation internationale sous la coupe de la puissance militaire majeure de l’époque, soustrayant à la justice, voire même à la simple condamnation, les plus importantes violations commises à l’encontre des humains au cours des 70 dernières années.
Dans ce cas, doit-on considérer les Nations unies comme une instance de référence adéquate pour l’instauration de la justice et la gestion pacifique du monde ? Et faire l’économie de la barbarie par des moyens qui donneraient justement à la violence une omniprésence tant chez l’oppresseur que chez l’opprimé ? Alors que les voix des États pauvres se vendent aux enchères même au sein du Conseil des droits de l’homme, est-il fondé de parler de démocratisation des institutions internationales ?
Des décennies durant, les sociétés civiles ont mené des luttes en vue de fonder une Cour pénale internationale. Pourtant, à ce jour, les États-Unis, le pays plus le plus puissant du monde, la Chine, le pays disposant de la plus grande densité démographique, et la Russie, le pays disposant de la plus grande superficie, se sont placés hors de la juridiction de cette Cour, sauf lorsqu’il s’agit d’ectoplasme d’États autorisés à rester membre de l’organisation internationale.
Tout recul de la justice cède le terrain à l’agressivité. Chaque recul de la dignité humaine ouvre grandement la voie à la sauvagerie.
La violence est le plus puissant dénominateur commun consubstantiel à la personne humaine. Selon la définition de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la violence est l’usage prémédité de la force matérielle ou du pouvoir, sous forme de menace ou de passage à l’acte effectif contre soi. Ou par le fait d’une personne, d’un groupe, ou d’une communauté à l’effet de faire naître un risque ou une grande possibilité d’être la cause d’une blessure, d’un meurtre ou encore la cause d’un dégât matériel ou d’un trouble de croissance et voire même d’un manque… Ou, comme le résume si bien Françoise Héritier, « toute contrainte de nature psychique ou corporelle ».
Cette contrainte, là, se manifeste comme un moyen d’autodéfense de l’ego, un moyen d’exprimer son soi en ce que les limites tolérées de la sociabilité deviennent illusoires dès lors que s’effondre le psychisme des individus et des groupements sous l’effet de facteurs divers ; un effritement qui commence à l’enfance et qui se prolonge en un syllogisme circulaire vers l’autodestruction de soi et d’autrui dont l’apothéose morbide trouve son expression dans cette formule : faute d’avoir partagé le monde de mon vivant, tu le partageras, contraint et forcé, dans notre mort conjointe.
L’insurrection est le fait d’individus réduits au silence par la structure dominante après en avoir été mis au ban de la vie. Selon cette logique, toute volonté de vengeance implique une volonté préalable de nuire. La société ne produit le pire qu’après avoir subi le pire de la dictature, soutient Moustapha Khayatti, résumant la problématique de la répression et de l’insurrection.
Ainsi, Benyamin Netanyahou peut justifier en toute tranquillité les crimes de son armée à Gaza par analogie avec les attentats de Londres. Le comportement du terroriste ne s’inspire pas des actes de sa cible (WHAT WE DO), mais de la nature profonde de sa cible (WHAT WE ARE). S’il est vraiment convaincu de ce qu’il dit, de quelle catastrophe est alors annonciatrice son extrémisme ? Benyamin Netanyahou, incarnation de l’agressivité en habit occidental, sait pertinemment qu’il peut faire ce qui lui chante au moment où il le veut, trouvant toujours auprès de dirigeants occidentaux du calibre de Barack Obama ou de François Hollande, aussi légers qu’un poids plume, la caution à tous ses crimes quels que soient leur degré d’atrocité.
La complexion psychologique du tueur et sa propre victimisation ne le prédisposent pas à bénéficier d’un préjugé favorable. Doit-on pour autant faire face à ce phénomène autrement que par sa banalisation, en le réduisant par exemple à un simple accident de civilisation ou à une crise susceptible d’être circonscrite ?
Le monde se trouve devant un grand vide, un fossé sans précédent dans l’histoire de l’humanité. La disparité s’étend en effet à tous les plans, à tous les niveaux : entre nord et sud, fort et faible, centre et périphérie, culture de référence et cultures marginales, monde des riches et monde des pauvres, civilisation des loisirs et peuples relevant du monde du dégoût.
L’économie de subsistance protégeait les peuples périphériques des anciens empires. L’insertion dans l’économie de marché est devenue un impératif pour le moindre village du coin le plus reculé de la planète imposé par la logique de domination. La destruction des moyens d’autodéfense classique une obligation impérieuse du processus d’emprise et de domination, un emmêlement constitutif de la construction de la sécurité nationale du dominant.
Quand la barbarie devient une des formes d’autodéfense de soi et de la patrie, quand la barbarie d’autrui s’octroie le pouvoir de qualification du « terrorisme », le pouvoir de propagation du fanatisme et de l’arriérisme, conduisant le vaincu à se conformer au schéma du vainqueur, se développe alors un classique exercice d’auto flagellation, pour reprendre une expression chère au sociologue Ibn Khaldoun.
Point n’est besoin d’imputer cet état de fait au marxisme frappé de mutisme, au libéralisme frappé de claudication, au nationalisme frileux replié sur lui-même, alors que l’extrémisme religieux devient une marque déposée arabe et islamique, en ce que ce phénomène traduit une profonde crise structurelle touchant la totalité de l’humanité.
À ce titre, l’Islam constitue une valeur sûre, la digue ambitionnant de contenir le déluge nous menant vers une crise des temps modernes. Mais, dans le même temps, constitue-t-il une riposte à l’absolutisme mondial avec des moyens d’autodéfense viciés par toutes ses pathologies et les pathologies des autres ? Est-il possible de décrypter le code en vue de neutraliser le générateur de haines qu’il recèle en lui depuis quinze siècles, hors des groupements musulmans, alors que la compréhension et l’assimilation de sa philosophie paraît ardue pour autrui ? Faut-il se croire capable de sensibiliser l’homme et la religion au xxie siècle autrement que par des récits éculés, dont l’utilité exclusive est de reproduire le schéma morbide de la mort et des tueries ? La puissance de la mondialisation a résidé dans les faits suivants :
- la généralisation de l’usage de la téléphonie mobile ;
- la banalisation de l’usage d’Internet en tant que moyen de communication et qu’arme de combat (de Manhattan à Gaza en passant par les favelas brésiliens et la ville d’Alep) ;
- la démocratisation du Kalachnikov, le fusil-mitrailleur de fabrication russe, très ordinaire dans les compagnies privées de sécurité et des groupements salafistes ;
- le choix du billet vert, le dollar (qui exhibe en toutes lettres sa doctrine « In God We Trust », et énonce ainsi en toute limpidité son mot d’ordre), comme dénominateur commun à tous les mercenaires, affairistes et pseudo-politiciens ;
- la réduction des droits de l’homme à un produit de commerce chez les puissants et de réduction des pertes chez les plus virulents ennemis des lois et règlements.
Le califat de Da’ech ne constitue donc pas une création ex nihilo. De la même manière que l’Européen s’est acquitté de rançons de l’ordre de 250 millions de dollars pour libérer ses otages en Afrique, en Irak et en Syrie, l’homme d’affaires irakien a été conduit à payer son dû mensuel pour protéger ses établissements de toute explosion – des attentats traités d’ailleurs abondamment dans les médias, avec force détails, allant de l’identification du lieu au nombre des victimes et du déroulement des opérations à l’identité de l’organisation responsable. Soit autant d’indices valorisant le maître d’œuvre des attentats.
Quant à l’argent salafiste de provenance pétro monarchique, il a servi dans un premier temps à financer les sessions d’entraînement en Afghanistan, puis s’est fait discret lors de la traque de sa traçabilité dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, avant de reprendre vigueur, réussissant finalement à édifier un système complet hors de l’économie du marché.
Les États-Unis ont cessé de construire des prisons secrètes et d’imposer des restrictions au « terrorisme », allant même jusqu’à déclarer avoir mis fin à leur guerre contre le terrorisme. Et la position des États-Unis ne constitue-t-elle justement pas en premier et dernier ressort l’ultime critère de détermination de l’Occident ? Malgré l’important déploiement de groupements qui relèvent tous de la définition du terrorisme (selon la Commission des droits humains), aucune de ces organisations ne figure sur la liste des États-Unis, sauf à considérer que l’administration américaine et ses services annexes ont failli à leur mission.
Est-il possible d’appréhender le phénomène de sauvagerie sans revenir sur l’expérience des chabihas [10] en Syrie ? D’occulter l’image de cette morgue sécuritaire qu’insupportait l’idée même d’une protestation pour changer le cours des choses ? Sommes-nous tenus d’éviter de mentionner les cas de vengeance rétroactive entre les familles des victimes de l’avant-garde combattante, la branche militaire des Frères musulmans et le pouvoir syrien, ruminées depuis la révolte de Hama (1991-1982) ? In fine, la violence est-elle en mesure de constituer un levier de transformation démocratique et de progrès au sein d’un mouvement civique et social de protestation ?
Les barils de chlore en guise d’explosifs produits par l’oppresseur et les obusiers d’enfer auxquels recourent le camp adverse, celui des opprimés, ne sont pas apparus du jour au lendemain dans les arsenaux des belligérants. Ils sont le fruit d’une évolution permanente des formes de violence et traduisent l’exacerbation du conflit.
En Irak comme en Syrie se dégagent des constantes, on relève des caractéristiques toujours identiques : intervention externe et interne, iranienne et saoudienne, obsession néo-ottomane d’Ankara en complément d’une pathologie tribale chez une fraction des élites syriennes matérialisée par leur aptitude à faire preuve de suivisme à l’égard du colonialisme.
Dans cette configuration, la compétence politique a fait défaut au bénéfice du mercenariat et de la schizophrénie de bon nombre de ceux qui se sont intronisés dirigeants du peuple syrien au paroxysme du déchirement humain et social de la nation.
La mutation d’un mouvement civique populaire en une guerre sale menée pour le compte d’autrui s’est déroulée en plein jour. Fait singulier, ceux qui sont les plus éloignés des valeurs de liberté, de démocratie et de révolution continuent d’occuper à ce jour les grands titres de l’actualité dans les colonnes traitant de « La révolution syrienne ».
La dictature est morte prématurément dans les esprits et les cœurs. La violence a reconstitué une économie de guerre fondée sur la corruption, impliquant les deux termes de l’équation, le corrupteur et le corrompu.
Les plus grandes victimes de la corruption sont aujourd’hui devenues les quémandeurs de compte en banque les plus actifs auprès de l’un, ou réclament des financements auprès de l’autre. Les pseudo-révolutionnaires ont creusé la tombe de la révolution avant celle du régime. Des méthodes pitoyables et désespérées ont été mises en œuvre en guise de mode féroce de vengeance par ceux-là même qui ont été intronisés, tant par les Arabes que par les Occidentaux, comme tuteurs du peuple syrien. Les services de sécurité occidentaux et régionaux n’ont pu éradiquer l’esprit de vengeance de leurs ouailles, dont l’usage a aboli les frontières pour en faire un drame sans pareil dans l’histoire de l’humanité, depuis la Seconde Guerre mondiale.
V. De la proclamation de la trêve à la proclamation du califat
Il est nécessaire d’éviter de transposer le cas irakien sur le cas syrien et inversement, car le djihadisme takfiriste a emprunté des voies différentes dans les deux pays. Cependant, la décision de l’État islamique d’élargir ses assises territoriales et son champ de bataille a bien charrié d’Irak vers la Syrie le virus de la banalisation du mal avec son cortège d’éradication, d’assassinats sans discernement, de viol, d’enlèvement, de décapitation, de profanation des cadavres. En un mot, la normalisation de la sauvagerie.
Le discours de mobilisation à tonalité religieuse et la guerre ouverte contre le régime et ses institutions ont trouvé en Syrie un terrain fertile tant dans les rangs des groupements djihadistes takfiristes qu’au sein des mouvements islamistes politiques traditionnels voués à l’extermination par le régime depuis 1980. Son homologue irakien a emprunté une démarche identique durant la même période [11], de même que parmi les adversaires du régime syrien sur un plan local autant qu’occidental. La tournure communautariste prise par le conflit s’est reflétée dans le discours politique.
Le premier manifeste, œuvre d’un zélote, a été amplifié via les réseaux sociaux islamistes de la toile. Les médias saoudiens et qataris y ont joué un rôle majeur dans la mobilisation psychologique et populaire en résumant le contenu en date du 10 août 2011, sous le titre « l’ère de la paix sécurisée islamo-occidentale », posant les conditions de la victoire.
Selon ce texte, la révolution syrienne ne saurait triompher sans la réalisation des trois conditions suivantes :
- La confessionnalisation de la révolution : la révolution doit adopter le clivage binaire confessionnel sunnite-chiite et souscrire à l’idée d’éradiquer l’influence safavide (empire safavide iranien) et nousseyrite et de ses alliés (les chiites).
- La militarisation de la révolution : en ce que le Prophète avait lancé un appel de ralliement à l’armée de Damas, il importait de se regrouper en vue d’un assaut contre les chiites au Liban, en Irak et en Iran, visant à se débarrasser de leur présence dans ces pays.
- Opérer une alliance avec l’Occident chrétien et solliciter son intervention : le Prophète ayant lancé un appel à une alliance islamo-occidentale en Syrie, il importait de préparer les esprits et le terrain à un tel rapprochement, conformément à la théorie de « l’ère de la paix sécurisée islamo-occidentale » et favoriser une intervention en Syrie du type de celle qui a réussi en Libye.
Ce mémorandum aurait pu passer inaperçu, mais c’était sans compter sur les Frères musulmans qui l’ont repris sur leur site, relayé par sept autres sites islamistes en moins de 24 heures. Sa diffusion a marqué un tournant dans le déroulement de la contestation populaire en Syrie. Celui qui a décrété par fatwa l’intervention militaire étrangère en Syrie est celui-là même qui a décrété par fatwa le djihad en Syrie, mettant l’accent sur la confessionnalisation du conflit, considérant la militarisation de la contestation comme unique voie pouvant mener à la chute du régime (y compris « l’opposition hôtelière », celle qui proclame un double refus depuis les hôtels où elle est hébergée : « Non au dialogue, non à la négociation »).
Dans une ambiance aussi exacerbée, renforcée par l’objectif de mettre en échec le « triple non » (« Non à la violence, non à la confessionnalisation du conflit, non à une intervention militaire étrangère »), toute proposition empreinte de modération constituait pour ses adversaires un acte assimilé à de l’apostasie ou équivalent à une traîtrise légitime ainsi l’assassinat.
Robert Ford, ancien représentant des États-Unis auprès de l’opposition syrienne, me l’a assuré, personnellement, très clairement : « C’est une guerre entre une majorité sunnite et une minorité chiite. Elle s’achèvera par le triomphe de la majorité numérique, même si cela doit prendre quelque temps. » Tout cela sans jamais mentionner la démocratie, et encore moins les droits de l’homme.
Robert Ford ne se doutait pas que ses amitiés djihadistes allaient déboucher sur des structures de solidarité tribales du même type que les conseils tribaux (sahouat) initiés par les forces d’occupation américaine pour combattre Al Qaida en Irak.
Il n’imaginait pas non plus que la bête par l’entremise de laquelle il s’est employé à opérer une percée stratégique après sa défaite en Irak est polycéphale, et qu’elle ne se priverait pas de couper la tête des siens avec la même vigueur que lorsqu’elle décapite un renégat.
Raqqa, place forte de Da’ech, a constitué un signal d’alarme pour quiconque porte les armes, qu’il s’agisse des gouvernementaux ou de l’opposition. La mentalité sécuritaire du régime a fermé l’œil sur ce phénomène en ce que de l’aveu même d’un journaliste syrien proche d’un officier supérieur de sécurité, qui m’en a fait la confidence, la présence de Da’ech à Raqqa va donner aux Syriens un avant-goût du pouvoir qui se substituera au régime dans l’hypothèse de sa chute.
L’opposition considère Da’ech comme une créature modelée dans les caves des services des renseignements syriens ou iraniens. Un fait qui a élargi le cercle des personnes susceptibles d’être frappée d’apostasie par Da’ech pour englober tous ceux qui accusent ce regroupement de force stipendiée.
En 1949, les augustes pays signataires des conventions de Genève ont mentionné à plusieurs reprises les quatre actes prohibés en tout temps et en tout lieu (cf. l’article 3 commun aux conventions de Genève) :
- L’agression sur la vie et l’intégrité physique, notamment l’assassinat sous toutes ses formes, la défiguration de la personne, de même que les sévices et la torture ;
- La prise d’otages ;
- L’atteinte à la dignité personnelle, particulièrement le traitement infamant, attentatoire à la dignité ;
- Rendre des jugements et infliger des châtiments sans jugement préalable devant un tribunal constitué selon les normes juridiques garantissant des droits judiciaires au regard des peuples civilisés.
Il est douloureux d’affirmer que la recension des violations des droits de l’homme par Da’ech relève d’un acte nihiliste en ce que ce groupement a instrumentalisé par la publicité les violations qu’elle commet dans l’intention de terroriser la population ou quiconque s’opposant à ces projets, afin d’assurer son emprise sur sa sphère.
Da’ech archive donc ces atteintes à la dignité humaine via les médias pour en amplifier la fonction pédagogique, érigeant le crime en vertu, considérant la sauvagerie comme un acte de djihad et l’assassinat d’autrui comme une nécessité pour établir le gouvernement de Dieu sur terre.
Cet état de sauvagerie n’est pas non plus une création ex nihilo. La graine a été plantée par le trio George Bush Jr., Dick Cheney et Ronald Rumsfeld. Le trio de l’exécutif américain de l’administration néoconservatrice républicaine (2001-2009) a en effet suspendu l’habeas corpus, autorisé la torture, rétabli les prisons secrètes et les listes noires. Aux pensionnaires de Bagram (Afghanistan) et de Guantánamo (Cuba), il a enseigné le fait que le droit international humanitaire est un pantin dont on peut se jouer à sa guise.
Nul doute que l’armée israélienne viole tous les droits, tous les lieux de culte et toutes les dignités. Nul doute que les caves des prisons de la puissance occupante américaine en Irak (de même que ses gouvernements et que les caves de la dictature syrienne) ont donné libre cours à la torture, à l’enlèvement et aux assassinats extrajudiciaires.
Mais, alors même que nous passions des semaines, des mois et des années à rechercher les indices des crimes des uns et des autres, Da’ech expose aujourd’hui très simplement les preuves de sa sauvagerie, les brandissant victorieusement à la manière de trophées.
La sauvagerie est un état complexe combinant incandescence religieuse et religiosité de type nazi, les deux plus odieux phénomènes de l’histoire de l’humanité de l’époque contemporaine. Dans un même mouvement, une forte déviance psychologique passe outre la violence et l’agressivité, et donne ainsi libre cours à leur déchaînement sans la moindre limitation. Elle représente la forme la plus primaire d’une frustration dans sa volonté de domination de l’argent, du sexe et du pouvoir et d’une conscience religieuse frappée de suspicion [12].
Da’ech se résume finalement en une opération d’autodestruction par destruction d’autrui – phase ultime de son processus – après avoir violé les attributs de son humanité, s’aidant d’une ceinture que les concepteurs de ce projet obscurantiste arborent comme ces petites pilules que portaient les dignitaires nazis.
En dépit de tous les interdits concernant le suicide dans la culture arabe et musulmane, un membre de Da’ech, qu’il soit Saoudien, Koweïtien ou Européen, n’hésitera pas à se suicider à l’heure de sa confrontation avec autrui. Cet autrui là qui l’a changé en lui plantant un fusil entre les yeux, entre allégeance, obéissance et humiliation. Et, s’il est chanceux cette fois, il lui sera permis d’opérer un transfert.
Notes
- [1] El Mahdi (Mahdiy en arabe, مَهْديّ, la « personne guidée par Dieu, celle qui montre le chemin ») ou le Mahdi Mountadhar (arabe : المهدي المنتظر, « le guide attendu ») ou le Khalifat Allah (« Roi élu par Dieu ») désigne le Sauveur attendu des musulmans. Il devrait apparaître à la fin des temps, ainsi que l’ont annoncé certains hadiths.
- [2]R.D. Laing & D.G. Cooper, Reason & Violence, a Decade of Sartre’s Philosophy 1950-1960, SSP, Londres, 1971, p. 101.
- [3]S. Freud, Considérations actuelles sur la guerre et la mort, Payot, 1999.
- [4] P. Jeammet, « L’actualité de l’agir à propos de l’adolescence », Nouvelle Revue de psychanalyse, n° 31, Les Actes, pp. 201-222.
- [5] F. Bougnoux, « Distinguer violence et agressivité », Les Violences.
- [6] M. Bruch, Réunion de l’Association internationale d’étude de la personnalité et du caractère, 14 mai 1977. Pour Paul Bernard et Simone Trouvé, un comportement agressif « vise consciemment ou non à nuire, à détruire, à dégrader, à humilier, à contraindre. Il se traduit de façon très variée, soit par des paroles blessantes, soit par des attitudes menaçantes, soit par des actes de violence » (P. Bernard & S. Trouvé, Sémiologie psychiatrique, Masson, Paris, 1977.)
- [7] E. Wolff, Instinct sexuel et agressivité, Guy Authier, Paris, 1978, p. 13.
- [8] E. Wolff, Le Complexe sadico-mystique.
- [9] G. Henein, « De la liberté comme nostalgie et comme projet », Les Cahiers de l’Oronte, n° 1, 1965, Liban, réédité par Arabie-sur-Seine, 1984.
- [10] On appelle « chabihas » les fiers-à-bras et les hommes de main des services syriens.
- [11] En 1980, la loi n° 49 a été adoptée par le conseil du peuple syrien prévoyant la peine de mort pour quiconque est affilié à la confrérie des Frères musulmans. Au même moment, l’Irak adoptait une loi préconisant la peine de mort pour les partisans du parti islamique Ad Dada. L’Irak était alors en guerre contre l’Iran et le parti Da’wa, un parti chiite soupçonné de sympathies pro-iraniennes.
- [12] Caractère inhumain, cruel, barbare d’une personne, d’un comportement ou d’un acte. Sauvagerie d’un assassin, sauvagerie d’un combat, d’une agression, d’une guerre. « La plupart des objets précieux, classés au musée de Cluny, et échappés par miracle à l’immonde sauvagerie des sans-culottes, proviennent des anciennes abbayes de France. » (Huysmans, À rebours, 1884). « Nous allons voir les lutteurs dans le West End. Ce genre de sport dépasse en sauvagerie ce que je pouvais imaginer, car, au bout de quelques minutes, les lutteurs se transforment en enragés et ne pensent visiblement qu’à une chose, qui est de tuer l’adversaire. » (Green, Journal, 1936).
Illustration
Copyrights © SIHR / Madaniya