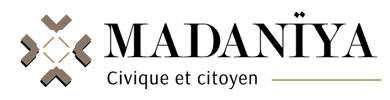Dernière mise à jour le 20 janvier 2024
Par André Paul : théologien et historien du judaïsme antique et rabbinique
Avec l’aimable autorisation de la Revue Golias, «l‘empêcheur de croire en rond», https://www.golias-editions.fr/golias-hebdo/
Avant-propos
Le conflit Israël-Palestine à l’épreuve des mots.
Les faits, à la vision insoutenable du 7 octobre 2023, perpétrés par une horde de tueurs aux méthodes défiant toute barbarie, ne marquent pas le début absolu d’une séquence noire de l’histoire du Proche–Orient contemporain. Les historiens, et eux seuls, auront pour tâche future de rechercher et d’expliquer en amont les raisons et les responsabilités de leur déclenchement. Nous n’en sommes pas là. Pour l’instant, la parole oscille entre émotion et commentaire, les deux d’autant plus mêlés, du fait surtout de la riposte vengeresse et ravageuse de l’armée d’Israël. Quoi qu’il en soit, on peut dire que l’événement fait de plus en plus l’effet d’un révélateur à plusieurs détentes. Ce qui veut dire, que par le douloureux truchement du drame et de l’horreur, il nous apprend à mieux lire et interpréter l’actualité.
Voilà ce que l’article d’André Paul cherche à montrer. Sans concessions, l’auteur fait l’inventaire critique des termes, des expressions ou formules utilisées, à l’unisson et mal à propos, tant par les journalistes que par les leaders politiques dont l’indigence historique irrite le connaisseur. Et de stigmatiser la dangereuse impropriété du lexique institué. Ainsi : « antisémitisme » ou « antijudaïsme », « confession juive », « État hébreu » et même « démocratie d’Israël ».
Depuis le milieu du siècle dernier, objectivement, l’État d’Israël est une réalité politique et géopolitique dont personne, absolument personne, ne peut mettre en cause l’existence. Pour autant, compte tenu des grands progrès dans l’approche historique de l’Antiquité proche-orientale, on ne saurait accepter les justifications ou revendications basées sur des évocations qui n’ont rien d’historique. De celles-ci, nous n’avons que des témoins à teneur mythique, sources inspiratrices de seules croyances religieuses.
Bref, il n’est plus possible de faire l’histoire de l’Antiquité avec la Bible, au demeurant le plus grand monument littéraire de l’humanité ; ni, partant, se référer à elle, ne serait-ce qu’implicitement, comme garante d’un projet politique ou d’une action militaire.
Ainsi informée, la démarche de l’historien nous apprend qu’il n’exista pas vraiment d’ « Etat d’Israël » avant 1948. Une terre, appelée dans l’Antiquité Ioudaia en grec, puis Iudæa en latin, accéda certes à l’indépendance, mais pour une durée d’un siècle et demi seulement. Par contre, un territoire nommé « Palestine » depuis de nombreux siècles avant J.-C., a perduré sans relâche jusqu’à nos jours, dans une succession d’occupations ethniques dont la dernière fut celle des Arabes, au milieu du VIIe siècle.
France – Israël – Palestine : L’«anathème» et les Zélotes sont de retour
Le soir de la fameuse manifestation contre l’antisémitisme, à l’initiative des présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, le 12 novembre dernier, interviewé à la télévision par le journaliste du service public Laurent Delahousse, le comédien Pierre Arditi, d’origine juive par son père et se disant « sans religion », s’est écrié : « Les Arabes sont aussi des Sémites ! » De par les conditions de son énonciation, la phrase contient son commentaire, et bien plus…
Sait-on que la formule antisémitisme n’apparut dans l’histoire qu’à une date relativement récente, en 1879 précisément ? On le doit au journaliste et polémiste allemand Wilhelm Marr, qui, en 1880, plaida pour l’expulsion de tous les Juifs en Palestine. Des historiens et linguistes du XIXe siècle, Ernest Renan en tête, avaient préparé le terrain en instituant la séparation entre Sémites et Aryens sur la base discriminatrice de la notion de « race ». L’écrivain juif de large notoriété, Bernard Lazare, « très sincèrement athée », reprendra le mot en 1894 dans son livre plusieurs fois réédité, récemment encore, L’Antisémitisme, son histoire et ses causes. On doit s’interroger sérieusement sur la pertinence actuelle du terme, plus encore sur celle de son usage exclusif concernant les Juifs. Dans l’Antiquité, d’autres peuples, et non des moindres, tels les Phéniciens et les Araméens, et d’autres, étaient sémites. En peu de mots, Pierre Arditi a bien posé la question. Une question qui, je le redis, implique une première et éloquente réponse.
De par son organisation, la composition de ses participants et les modalités de son déploiement, la démarche du 12 novembre a fait montre de nombre d’ambiguïtés. Il y avait quelque chose en elle d’une croisade politique. Ce que, dans sa livraison du 22 novembre, Golias Hebdo n’a pas manqué de relever.
J’insisterai ici sur les motivations réelles du parti de Mme Le Pen et de M. Bardella, mais à la lumière récente des dernières élections aux Pays-Bas remportées haut la main le 22 novembre par le leader populiste Geert Wilders. Sitôt les résultats du scrutin connus, Mme Le Pen s’empressa de féliciter son homologue néerlandais dont elle partage largement les thèses et le projet.
Or, l’argument majeur de ce nouveau leader européen, c’est la lutte implacable, non contre l’islamisme mais contre l’islam lui–même, qu’il désigne comme un danger historique et planétaire, allant même jusqu’à dénigrer la « culture musulmane ». Ne confond-il pas, sciemment peut–être, « arabe » et « musulman » ? Nul doute que, ignorant que les Arabes sont des Sémites, l’ex-Front national n’ait profité des ambiguïtés de ce mouvement bien plus politique que populaire contre l’antisémitisme, pour, objectivement, mieux promouvoir lui-même son aversion de l’islam et des Arabes.
La non pertinence ponctuelle de l’ « antijudaïsme »
Au lieu d’ « antisémitisme », on lit parfois, ou l’on entend : « antijudaïsme ». Mais là encore, peut-on se satisfaire ? Ce qui est visé, ce ne sont pas les Juifs comme individus, collectivement ou non, mais le judaïsme, système historique au caractère à la fois, et nécessairement, social et religieux. Le mot grec ioudaismos date de l’Antiquité ; opposé à hellénismos, il désignait la manière judaïque de vivre. C’est tout. Dans ce sens, on le rencontre dans le IIe livre des Maccabées, texte retenu dans la Bible catholique seulement.
Ce sont les chrétiens qui, dès le début du IIe siècle, institueront le mot ioudaismos dans sa signification pour ainsi dire classique. La fameuse lettre aux Galates du Nouveau Testament l’utilise déjà dans ce sens. Mais, comme je l’ai largement démontré ailleurs (Le Christ avant Jésus, éd. du Cerf, 2021), vu leur maturité doctrinale et cultuelle et déjà la précision de leur vigoureuse et constante polémique contre les courants chrétiens jugés déviants, les pièces épistolographiques portant la signature pseudonymique de Paul ne sauraient être antérieures à la fin du Ier siècle sinon le début du IIe. Notons que de longs siècles durant, l’usage de ioudaismos, en grec d’abord puis dans ses équivalences linguistiques diverses, sera l’apanage exclusif des voix ou plumes chrétiennes. L’hébreu yahâdût, très rare au demeurant, ne se repère pour la première fois que dans un Midrash (commentaire rabbiniques d’un livre saint) du XIIIe siècle.
Le vocable « judaïsme » désigne un système éthique et social, culturel et religieux avec sa vision du monde propre, sa conception de l’homme vivant dans une relation d’Alliance avec « son » Dieu définie dans la Torah, essentiellement représentée par le Talmud.
Concrètement, ce système se caractérise par : 1) Une communauté qui se rassemble avec les qualités constitutives de l’ « assemblée sainte » dénommée, ad intra seulement, Israël ; 2) Un corps de doctrines et de règles, de traditions et d’écrits transmis et étudiés sous le nom quasi mythique de Torah, à la fois Terre et Temple portatifs ; 3) Une terre, Érets Israel ou « Terre d’Israël », ayant, où que l’on vive, la valeur de référence symbolique aux forts accents d’utopie. L’adjectif « judaïque » embrasse tout cet ensemble.
Mutatis mutandis et dans le contexte actuel surtout, « antijudaïsme » ne saurait guère mieux convenir que « antisémitisme ». Et combien de Juifs, en Israël plus qu’ailleurs, répondent-ils à cette définition du «judaïsme» ? À la limite, le vocable «judéophobie» pourrait convenir. Il concerne en effet tout Juif, croyant ou non. Mais on ne le lit ni ne l’entend jamais nulle part.
Bien des Juifs n’ont aucune adhésion religieuse
Depuis le 7 octobre et les horribles tueries survenues sur les terres d’Israël d’abord, de Gaza ensuite, de la part des journalistes et des leaders politiques, l’ambiguïté des formules employées pour désigner les Juifs, d’Israël et d’ailleurs, n’a d’égal que leur misère. Y compris dans la bouche de personnalités dont nul n’ignore la culture. Qu’il s’agisse même du président Emmanuel Macron et de son éminent ministre Bruno Le Maire – néanmoins normalien et agrégé de lettres avant d’être énarque -, et de bien d’autres, on englobe les Juifs dans la « confession » juive. Le 12 novembre, Madame Borne était moins dans l’errance, sans en sortir néanmoins, en disant « religion ».
Je rappelle tout d’abord que le mot « confession » n’a de pertinence sémantique que dans le cadre du christianisme. Il désigne les Églises nées des grandes ruptures ou « schismes » que sont essentiellement le protestantisme et l’orthodoxie. Le catholicisme étant planétairement dominant, on est peu enclin à le désigner de la sorte. C’est une banalité de rappeler que les Juifs, et loin de là, ne sont pas tous croyants. On ne saurait donc les rapatrier globalement et de force sous la seule bannière d’une appartenance religieuse. Que l’on me permette d’évoquer David Ben Gourion qui, à l’âge de 62 ans, le 14 mai 1948, déclara l’existence de l’État d’Israël, était marxiste et athée. Il n’avait jusqu’alors jamais mis les pieds dans une synagogue. Comment oserait-on lui imputer une adhésion croyante ? Comme on le fait presque unanimement, à la faveur des événements récents et dans un conformisme d’aberration, pour la totalité des membres du groupe juif. S’exprimer ainsi à propos des Juifs doit être considéré comme chose gravissime. C’est nier l’histoire, spécialement celle des trois derniers siècles. Je vais y revenir.
On ne saurait parler d’un « État hébreu »
Une autre formule apparaît dans à peu près tous les discours ou tous les textes : « État hébreu ». Journalistes et politiques s’accordent aussi sur ce point, discutable s’il en est. En s’exprimant ainsi, on laisse entendre que tous les sujets ou citoyens de l’État d’Israël appartiendraient au « peuple de Moïse », dont, selon la légende antique, les ancêtres auraient traversé miraculeusement la mer Rouge et gagné la terre promise après quarante jours dans le désert. On est ici, non dans l’histoire mais dans le mythe.
Celui–ci a été intégré et valorisé dans une synthèse historiographique relativement tardive, à but nationaliste strict, et conservée dans des textes déclarés « saints ».
Dans le contexte culturel dont l’objectivité rationnelle est la base, comment peut-on s’accommoder d’une telle négation de l’histoire, seule apte, et encore, à des conditions à définir, à légitimer le présent ? Ce serait tomber dans le piège d’un mimétisme biblique justifiant tous les excès, jusqu’aux plus ravageurs. Et cela, je vais le dire, n’a pas manqué.
De plus, comment expliquer que ces personnes, s’affichant ainsi comme si subtilement informées, paraissent ignorer que vingt pour cent des citoyens, disons bien citoyens, de l’État d’Israël, sont arabes, et certains de ces derniers d’appartenance chrétienne. Descendants d’autochtones palestiniens à l’enracinement pluriséculaire, ces groupes ont leurs représentants comme députés à la Knesset. En 1962, au séminaire de Saint-Sulpice, il y avait quatre séminaristes de Galilée dont la langue ethnique, culturelle et cultuelle était l’arabe et l’idiome administratif l’hébreu israélien. Comble d’une ironie dont l’Église romaine d’alors pouvait avoir le secret, je dus leur enseigner le latin !
On parle l’israélien et non l’hébreu
Cela étant, est-ce l’adoption officielle de l’hébreu comme langue administrative qui permettrait de nommer « État hébreu » l’Israël de 1948 ? On peut en douter. Appelée « hébreu », ladite langue a pour base linguistique un dialecte hébraïque russe à usage communautaire et cultuel. Le savant hassidique Éliézer Ben-Yehûdah (1858–1922), auteur d’un merveilleux Thesaurus totius hebraitatis, eut le projet de transformer ce parler local à l’horizon sémantique étriqué en une langue moderne à usage courant. Voilà la base de l’hébreu israélien d’aujourd’hui. À force d’emprunts, y compris à l’arabe, bien enrichi du point de vue du lexique, de la syntaxe et de la prononciation, on aura créé l’hébreu moderne des Israéliens. Au vu de l’histoire linguistique des Juifs dans le monde, face à l’ample éventail des judéo-langues à usage régional – judéo-persan, judéo-arabe, judéo-berbère, judé-espagnol ou ladino, judéo-allemand ou yiddish et jusqu’au judéo-alsacien – je préconiserais que l’on parlât plutôt de judéo-israélien sinon d’israélien tout court.
Que l’on me permette une autre remarque. Si l’on met à part les juifs implantés depuis des générations en Palestine, qui parlaient traditionnellement l’arabe, réservant l’hébreu au culte synagogal et à l’enseignement rabbinique, bien des groupes de populations continuent de privilégier quotidiennement leur langue d’origine : le russe ou l’ukrainien entre autres, mais aussi l’anglais et le français, et jusqu’à l’éthiopien chez les Falashas. D’ailleurs, il semblerait que l’anglais soit pour les Israéliens, de tous milieux, une sorte de seconde langue généralisée à la manière d’une vraie koïnè. Exit donc tous les faux repères d’un « État hébreu ».
Une indépendance d’un siècle et demi seulement
Que l’on me permette ici un rappel historique, très schématique. Dans l’Antiquité, dont les témoins fiables, littéraires ou non, archéologiques surtout, nous permettent une approche authentiquement historique, les ancêtres des Juifs – ce mot ne date que de notre Moyen Âge – ne sont vraiment identifiables qu’à partir du VIe siècle av. J.-C. Les Perses achéménides étaient alors les maîtres des terres orientales, et parmi celles-ci, la mince province de Yehûd, devenue en grec Iouda ou Ioudaia après les conquêtes d’Alexandre, enfin Iudæa avec l’occupation romaine. Les habitants ou ressortissants seront successivement les Yehûdin en araméen, les Ioudaioi en grec et les Iudæi en latin. De nos jours et de plus en plus, l’historien se doit d’émettre de lourdes réserves quant à l’utilisation de l’historiographie mythique des livres bibliques, même ceux que l’on dit « historiques » – Les Livres des Rois et de Samuel-, pour faire l’histoire de l’Antiquité judaïque.
Les gens de Iouda n’accédèrent à l’indépendance qu’avec les Hasmonéens ou Maccabées, vers -168 et jusqu’à -63, Pompée entrant alors à Jérusalem. « Roi des Juifs » au règne prestigieux mais « client » servile de Rome, Hérode le Grand régna sur la Ioudaia (on parlait grec à la cour du monarque à Jérusalem) de -37 à environ -5. Dans l’Antiquité, le territoire des Ioudaioi ou Iudæi, dont le centre névralgique de la régulation nationale et religieuse était le Temple de Jérusalem, ne fut donc politiquement indépendant que durant un siècle et demi. Il faudra attendre le 14 mai 1948 pour qu’un État d’Israël existe, mais peuplé à la fois, redisons-le, et de Juifs et d’Arabes. Durant ces deux périodes antiques, à force de conquêtes, la Ioudaia s’était trouvée élargie aux dimensions de ce qu’Hérodote, au début du -Ve siècle, et d’autres avant lui, appelaient hè Palaistinè, « la Palestine ».
L’historien est à même de démontrer que la Palestine (en réalité hè Suria Palaistinè, « la Syrie Palestine »), littéralement la terre des Philistins, était première dans l’histoire, plus de deux millénaires avant sa conquête par les Arabes musulmans, en 636.
On est loin de ce que revendiquent, plus encore que certains de leurs prédécesseurs, les leaders actuels d’Israël. À propos de l’État d’Israël, j’ai dit « existe » et non « ré-existe » ou « ressuscite ».
Dans l’Antiquité, il n’y eut jamais d’entité politique du nom d’Israël. Du point de vue politique et géopolitique, diplomatique et commercial, c’est-à-dire dans toute communication ad extra, il y n’y eut que Yehûd puis Iouda ou Ioudaia, Iudæa ensuite. Israël était une appellation auto-désignante, à la fonction exclusivement ad intra ; une sorte de nom de baptême dont on réservait l’usage aux documents d’historiographie nationale de caractère mythique : ces textes que très tardivement on désignera comme « bibliques ».
Là, comme abstraits de concert des contingences cosmiques et ce faisant terrestres, Dieu et les hommes usent du même langage, ceux-ci pleinement motivés par la quête de la voie univoque de leur salut. Nul ne saurait faire l’histoire avec un tel matériau !
Le constat d’une Palestine presque éternelle
Revenons à la Palestine. À la mort d’Hérode le Grand, définitivement avec la déposition, en l’an 39, de son fils Antipas Tétrarque de Galilée, l’ensemble des territoires, qui allaient du Golan au nord au Néguev au Sud, constituèrent la province romaine de Palestine. Les deux défaites des Iudæi face aux troupes romaines, en 70 et en 135, ne firent qu’alourdir la mainmise militaire et administrative de l’Urbs. Lors de la seconde, du fait de l’empereur Hadrien, Jérusalem devint une vaste colonie païenne entièrement repeuplée et dotée d’un autre nom, Aelia Capitolina. À la longue, beaucoup oublieront « Jérusalem ». À partir de Constantin, la ville, qui retrouva son nom historique et devenue la « ville sainte », et avec elle l’ensemble du territoire palestinien, furent progressivement colonisés comme chrétiens. Jusqu’à l’arrivée des Arabes en plein VIIe siècle, ils resteront sous la domination, volontiers répressive pour les Juifs, du pouvoir de Byzance.
Il y avait par ailleurs la puissante et rayonnante communauté juive des bords de l’Euphrate, bien mieux traitée par les Perses sassanides puis par les Arabes abbassides. Dans le sillage de la diffusion du Talmud de Babylone, monument littéraire que ses maîtres avaient achevé dans le courant du VIe siècle, un débat s’instaura pour savoir si la terre originelle des Juifs était la Judée avec Jérusalem ou bien la Babylonie. Rarement sinon jamais évoqué, ce fait est néanmoins intéressant à connaître.
Des débuts du XVIe siècle à la Première Guerre mondiale, avec plusieurs éclipses aux effets plus ou moins graves et durables, dont, par exemple, l’invasion par les troupes de Bonaparte, la Palestine persista comme province de l’Empire ottoman. De 1923 à 1948, elle sera placée sous le mandat britannique, qui prendra fin le lendemain même de la déclaration de l’État d’Israël par Ben Gourion. En 1947, résistant au projet de l’ONU, le Premier ministre de Sa Majesté, Clement Attlee, déclara : « S’il y a partage de la Palestine, ce sera la guerre. »
Et guerre il y eut, dès le 15 mai 1948 ; quasiment ininterrompue, elle sévit plus que jamais. Voilà pour la Palestine, au destin tri-millénaire sinon plus. Mais qu’en est–il des Juifs ?
Juif et citoyen ou citoyen juif
Classer systématiquement et globalement les Juifs comme relevant d’une « confession » voire « religion » peut signifier aussi un anachronisme ou un recul historique criant, ce qui nous ramènerait au statut des Juifs d’avant l’ère des Lumières. Mais peut-être, à la réflexion et compte tenu de l’actualité politique d’Israël et des Juifs plus largement, y-a-t-il à cela quelque pertinence. ? Je vais m’en expliquer.
En France, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et ailleurs en Europe, les Juifs ne pouvaient quitter une communauté, parfois un ghetto, sans entrer dans une autre. On pouvait ainsi répondre à la question : « Qui est juif ? » Celle de savoir « ce qu’est être juif » ne se posait pas, ni d’ailleurs ne pouvait se poser. Le jour où elle le pourra, et se posera vraiment, les temps de l’identification de la judaïté et de la judéité, autrement dit du judaïsme et de la chose juive, ne seront plus. D’autres commenceront : il sera possible d’y être juif sans appartenir à la « communauté sainte » et donc sans professer nécessairement le judaïsme. À l’égal de tout homme, le Juif sera reconnu comme citoyen conscient et libre. Le 27 septembre 1791, après une longue lutte, fut enfin proclamée la pleine citoyenneté des Juifs de France. Dans son livre de 1989, L’Emancipation des Juifs 1789-1791, Robert Badinter écrivait : « Nulle part, sur le continent, même en Angleterre ou en Hollande où ils étaient bien traités, même en Autriche où Joseph II avait pris en leur faveur des mesures importantes, même en Prusse où brillaient les lumières du judaïsme berlinois, les Juifs n’étaient reconnus par la loi comme des citoyens égaux en droits à tous les autres. » (p. 15).
Quand nos hommes politiques et nos journalistes français identifient les Juifs à des membres d’une « confession » ou d’une « religion », ne font–ils pas fi de ces avancées décisives liées à l’avènement de la République, et conjointement à l’avènement de tout Juif au statut d’homme à part entière et de citoyen libre ? Les données de l’actualité me contraignent de poser la question, et d’y répondre positivement.
Les signes d’un sionisme dévoyé
Le sionisme de Théodor Herzl (1860-1904) trouva le remède préventif aux dangers de dissolution de la judéité que représentait l’émancipation des Juifs. Et de préconiser « la mise en œuvre de l’émancipation collective par la démarcation territoriale et politique ». En d’autres termes, il s’agissait de normaliser l’émancipation. Dans un premier temps, on n’envisagea pas la Palestine comme terre d’élection ; on chercha dans les espaces de l’Amérique latine et même en Afrique.
Quoi qu’il en fût, le modèle sioniste inventa la formule qui permît que l’émancipation conservât tous ses droits, mais sur la base de la reconstitution, du rayonnement et de la reconnaissance d’une entité nationale géographiquement définie dans un pays où les Juifs disposeraient totalement de leur destin. Je cite ces autres lignes éclairantes :
« Le sionisme paraît offrir une postérité à la judéité : il permet au Juif, même dépourvu de lien véritable avec la pensée et le mode de vie juifs, de trouver un sens juif à sa vie sans pour autant adhérer à la religion. Le sionisme s’annonce bien comme une entreprise laïque ; il rend possible un déplacement de l’identité juive vers des sources liées à la conscience spécifique d’une existence. Il dispense le Juif, désireux de garder son identité ethnique, du choix entre assimilation et adhésion à une idéologie religieuse. » (J. Chemouni, Freud et le sionisme, p. 74).
Face aux scènes horribles qui nous submergent de regrets, combien ces phrases peuvent-elles aujourd’hui nous faire rêver ! Où est passé ce sionisme si magnifiquement décrit ?
Israël n’est plus une démocratie
Dune façon unanime et récurrente, et avec insistance, journalistes et politiques présentent Israël comme une démocratie. Certes, l’esprit démocratique des pays dits occidentaux anime l’âme politique de la grande majorité des citoyens israéliens. Mais depuis quelques années et plus que jamais, l’État se trouve aux mains d’hommes et de partis qui pensent, décrètent et agissent de façon non démocratique. Bien avant les innommables massacres du 7 octobre 2023, les interventions rugissantes de M. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, ne semblent–elles pas celles d’un Zélote assassin parachuté au XXIe siècle ? Un Zélote non seulement tueur mais aussi conquérant. Si le Hamas vise l’anéantissement de l’État d’Israël, le ministre Ben-Gvir, lui, refuse toute terre sinon toute vie aux Palestiniens. Les mots sont là !
Quant à M Netanyahu, le chef du gouvernement, il profite de l’occasion pour tenter de se racheter auprès d’une population qui lui est majoritairement hostile. Dans la revanche militaire qu’il met en acte, n’applique-t-il pas ce que les livres de l’Ancien Testament appellent en hébreu le harem, l’ « anathème ». Ce terme à connotation rituelle désigne l’extermination d’une population et la destruction totale de ses biens. Et aujourd’hui, on est consterné par le fait que des hommes politiques devenus chefs de guerre sembleraient considérer ces mœurs antiques comme leur modèle. Un modèle sacré en quelque sorte.
Et l’on pense à ce passage du Livre du Deutéronome : « Yahvé notre Dieu nous le (l’ennemi) livra et nous le battîmes, lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons alors pris toutes ses villes, et nous avons voué à l’anathème (c’est-à-dire détruit ou tué) toutes ces villes, hommes mariés, femmes et enfants, sans rien laisser échapper » (2, 33-34).
Prétendre annihiler par des bombardements les éléments armés du Hamas au milieu de deux millions et demi d’habitants resserrés sur l’équivalent d’un arrondissement français, évoque cette terrible phrase imputée à Simon de Montfort avant le siège de Béziers en 1209 : « Tuez–les tous, Dieu reconnaîtra les siens. »
Aucune issue honorable en vue à cette heure
La situation est grave et aucun avenir ne saurait être envisagé. Parler de «deux États» comme d’aucuns leaders politiques le font, relève du langage chimérique. Il est bien trop tard, et qui peut oser dire qu’il est trop tôt ? Personne ! On ne construit pas un État sur des ruines jonchées de cadavres, ni sur la haine partagée que ces situations animent. Au vu des omissions généralisées qui, chez les pays du monde concernés de près ou de loin par la situation actuelle, ont précédé et pour partie expliquent l’événement barbare du 7 octobre dernier, et compte tenu des actes insensés de vengeance dont nous sommes témoins de la part de l’armée d’Israël, l’unique perspective imaginable est la réédition au carré des faits consécutifs à la guerre des Six Jours de juin 1967 : l’extension et le renforcement de l’occupation des restes de la Palestine par Israël. Celui-ci ira-t-il jusqu’à l’annexion, selon le projet même du parti de M. Ben-Gvir ? Après tout, ce fut impunément le cas pour le Golan syrien, annexé en 1981 ?
Illustration
MOHAMMED BADRA / EPA)